Serez-vous prêt à vous perdre dans ces forêts narratives, et à en ressortir transformé-e ?
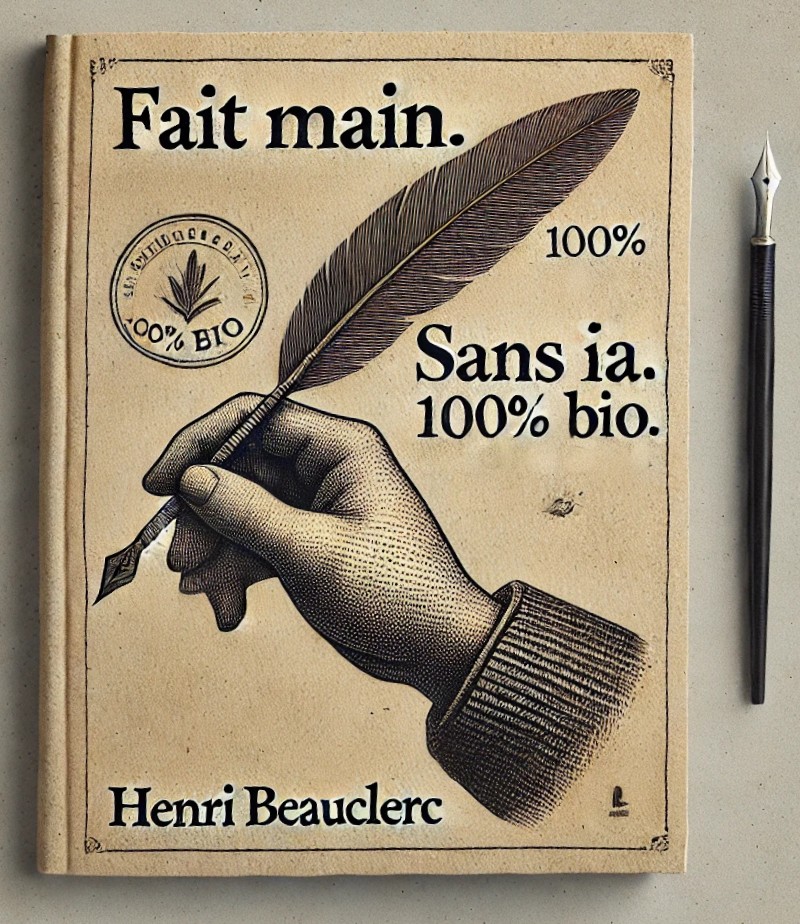
Dans ce recueil foisonnant, les histoires s’entrelacent autour de thèmes universels tels que la mémoire, la nature, et les absurdités de l’existence moderne. Qu’ils évoquent une forêt disparue remplacée par une cité, un algorithme dictant les règles de la vie et de la mort, ou encore la quête d’un homme pour réinventer sa propre liberté, ces récits révèlent une humanité à la fois fragile et résiliente.
Entre tensions écologiques, réflexions philosophiques et instants suspendus, ce recueil est une ode à la complexité du vivant, à ses failles et à sa beauté. Une invitation à lire entre les lignes, à ressentir, et à rêver.
Sommaire
Logarythmie
Planche de salut
L’arbre d’hier
Nu
Fleurs de Kalash
Oëtre ou ne pas être
Viatique antique
Jardin de nostalgie
Préhistoire d’amour
Ici et maintenant
L’arbre nain
Cot part
Double « je »
Au nom de la chose

Logarythmie
Dans un monde où l’écologie du meurtre est devenue la réponse extrême à la surconsommation, Moshé exécute froidement les verdicts d’un algorithme infaillible. Mais jusqu’où peut-on obéir sans questionner ? Une réflexion glaçante sur la justice, la moralité et la finitude.
Nouvelle primée 2024 Mayet sur Sarthe

Je sais, j’ai un sale boulot. Mais c’est comme ça. J’élimine ceux qui éliminent, ce n’est que justice. D’ailleurs, c’est elle qui me rétribue. La planète. Elle réclame une sorte d’écologie du meurtre.
Dans les années deux mille, les puissances occidentales avaient conçu un indicateur d’alerte, sur l’exploitation annuelle des ressources naturelles. L’humanité connaissait ainsi chaque année le jour exact, où elle vivait au-dessus de ses moyens. Le commun des citoyens n’en tirait qu’une anecdote type buzz, pour agrémenter la platitude de ses conversations.
Mais autre temps autre époque.
Celui-là, c’est son tour aujourd’hui. Deux août 2032, 13h 02. J’ai encore une minute. Ça me suffira. En général, je bénéficie de l’effet de surprise. Les gens ne se rendent pas compte. Je ne sonne pas. J’entre. Pénètre dans sa vie. Il prépare une salade d’été avec les courgettes grillées qui restent du barbecue d’avant-hier. Je préfère qu’ils ne me perçoivent pas et ne pas croiser leur regard hagard. Je tire dans le dos. Dans la tête. Deux coups rapprochés presque à bout portant. Il faut avoir la main sûre dans cette activité. Je repars en dévissant mon silencieux machinalement. Shit. J’ai taché mon jean.
Max est un ami et Judith, et Sara, et Ismaël. Moi, c’est Moshé. On ne sait pas combien nous sommes, mais ceux-là ont appris le métier ensemble.
Max lui aime quand les gens se retournent avant de mourir. Un sadisme de circonstance qui constitue une sorte de pourboire en fin de mission.
Tiens la première femme de la journée. Centre-ville. Ça me va. J’en profiterais pour acheter de quoi manger. Deux août 14 h pétantes. Ça tombe bien. Le garage est ouvert. Elle sort les courses de sa voiture. Je laisserais le corps coincé par le coffre qui s’est refermé au moment où elle s’est affalée.
Ce n’est pas nous qui choisissons. C’est l’algorithme. L’algorithme ne se trompe jamais. Il faut que nous croyions à ça. Alors j’y crois. Ça m’évite de me poser des questions inexistentielles.
Les enfants, c’est très rare. En trois ans juste un ado. C’est Sara qui l’a traité. Faut dire que c’était un gosse de riche. Il avait abusé de la prodigalité à outrance pour son âge. Ses parents cédaient à tous ces caprices alors… C’était comme ça. Le logarithme décidait, et nous, on agissait.
Bon la banlieue. A 23 heures, c’est normalement un peu dangereux. Mais bon. J’ai mon arme. Je ne crains pas grand-chose. Il faut que je reste discret cependant. C’est dans la charte de déontologie. Pas d’esclandre. Rester dans l’ombre et ne pas affoler la population. Objectif louable mais ambitieux. Car tous ces crimes inexpliqués à la longue ça crée au mieux un sentiment d’insécurité, au pire une bonne psychose collective.
Sixième étage droite. Appartement 22. Délicat d’assurer la ponctualité exigée. Il doit être en famille. Peut-être devant une projection. Mais lui, c’est 23 h 23. Alors ce sera 23 h 23.
Je vais faire le voisin affolé. Ça a déjà marché. Je tape. La porte s’ouvre sur une vieille femme voilée. « Bonsoir pardon de vous déranger. Je viens d’accrocher une voiture en bas. On m’a dit que c’était la vôtre… »
L’homme a vaguement entendu l’échange. Sa trogne alcoolisée apparaît au-dessus de l’épaule de la femme. « Laisse Leila. J’y vais. »
Sur le palier du cinquième un corps en sang attend d’être découvert pour être pleuré par les siens. Ma montre indique 25 quand je sors de l’immeuble. Je file me coucher.
Le logarithme ne dort jamais lui. Il calcule. Mis au point il y a une dizaine d’années, il traque les données de chacun depuis leur naissance. Chaque achat, chaque minute d’électricité, de recherche internet, de trajet… Tout est converti en unité de consommation de ressources planétaires. Le logarithme obéit à une norme décidée, on ne sait plus trop par qui.
Plus grand-chose en mémoire dans mon mur d’images virtuelles. Je me passerai de fiction ce soir. Il est tard et je suis crevé. Un alcool de synthèse fera l’affaire avant de me coucher. Pendant que je m’injecte à petites doses savoureuses, je regarde le planning de demain. Cinq personnes sont en rouge dans ma zone. Il suffira pour deux d’entre elles de commander un voyage, ou de passer plus de trois heures sur un écran pour passer la norme. Les autres ça dépendra. Peut-être pour après-demain.
Ils ont décidé de cette norme dans l’urgence à agir pour la survie de l’humanité. Chacun a sa naissance dispose d’un nombre d’unités. Ce capital doit lui permettre de vivre une vie raisonnée s’il adopte un comportement respectueux de l’environnement. S’il fait le choix d’aller au-delà, il perd son droit de prélever des ressources. Le logarithme calcule en permanence le nombre d’unités individuelles consommées. Dès que ça dépasse, il nous mandate pour arrêter radicalement le gaspillage. Je sais, je vous l’ai dit, j’ai un sale boulot. Mais c’est comme ça. J’élimine ceux qui éliminent, ce n’est que justice.
La nuit a été paisible. Je ne cauchemarde jamais. Mais je ne rêve plus non plus.
Un café, une tartine. L’odeur qui me parvient n’est pas celle que j’espérais. Le grille-pain vient de rendre l’âme. Juste le temps d’en commander un sur le net. Pas le temps de le faire réparer. Mon premier client est dans une heure. Bon, c’est dans mon quartier. Ce devrait aller.
On sonne. C’est Max. « Bonjour, je passais dans le coin. J’ai un client logué dans peu de temps alors je me suis dit qu’un petit café chez un ami… »
« Entre et sert toi. C’est dans la cuisine. Je vais m’habiller si je ne veux pas rater mon rendez-vous. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Max, qu’est-ce que tu fais ? »
L’homme rengaine amusé : « C’est Moshe. Je sais. Y’a des jours avec… et des jours sang ! »
Mais le logarithme ne se trompe jamais.

Planche de salut
Un homme ordinaire décide de transformer sa vie en une quête héroïque. Mais ses résolutions grandioses prendront-elles la tournure qu’il imagine, ou lui révéleront-elles une vérité bien plus ironique ?

Il décida de changer sa vie ce jour-là. Et son esprit vide de préoccupation quotidienne, s’emplit soudain de mille pensées stratégiques.
Il se donna la matinée pour atteindre son objectif. Avant qu’elle ne rentre déjeuner.
Les yeux perdus au loin, il trempait sa tartine de miel dans le bol à son prénom. Il devait prendre des forces. Quel sens avait sa quête ?
La façon dont il avait toujours vécu le monde se fragmentait. Partout, l’ordre établi masquait l’aliénation des masses par les minorités dominantes. Le monde courrait à sa perte, depuis que deux groupes d’hominidés s’étaient affrontés dans une steppe gelée. L’horreur envahissait chaque méandre de son cerveau, comme l’encre écarlate d’une pieuvre noire. La pollution, la civilisation du gaspillage, le génocide des espèces… Mais où pouvait se cacher la goutte d’eau pure, dans cet océan de merchandising généralisé. Ses yeux se gonflèrent à la pensée du sort des femmes dans les camps de réfugiés, à l’invisibilisation des fillettes afghanes, à la torture des adolescentes iraniennes, aux morts abortives sur le nouveau continent, aux mutilations féminines en Asie et en Afrique, aux combattantes de tous les fronts, et aux victimes passives de toutes ces luttes. La cause des femmes, plus que tout autre, s’ajoutait aux malheurs générés par la bipolarité instinctive d’extinction et de survie, de la condition humaine.
Au fur et à mesure que défilaient les images, il se partageait entre un abattement total, et une force indicible qui le poussait à la rébellion. En achevant de s’habiller, il n’osa pas se regarder dans le miroir de la penderie. Il se sentait d’une lâcheté profonde, presque identitaire. Que pouvait-il y faire après tout ? Il lui semblait, jusqu’à aujourd’hui, avoir réussi sa vie d’homme, de mari, et de père. Un enfant, est-il responsable de son éducation ? Un Occidental, est-il coupable de penser, vivre, réagir, voir le monde, en Occidental ? On l’avait ainsi formaté. Et ce « on » représentait ses parents, ses professeurs, les adultes qu’ils croisaient, les journalistes qu’il lisait, les animateurs qu’il regardait, les politiques qui manœuvraient, les influenceurs qu’il évitait. Tous les discours le ramenaient à sa posture d’homme accompli ; tous ses actes à la condition de citoyen ordinaire. Cette vie lui apparaissait ce matin, comme un carcan de douleurs. Une mise en case étriquée, de laquelle il devait s’extirper, exploser. Et transformer son angoisse existentielle en une lutte pour les droits, le respect, l’équité. Ces mots seraient ses armoiries, en cette journée de mars. Ici et nulle part ailleurs. A 10 h 30, sa belle maison de maître devenait le centre du monde, sur la carte des champs de bataille. Le combat allait commencer pour lui et toute l’humanité. Mais comment faire ?
D’ordinaire, quand il voulait prendre du recul sur ses responsabilités, il mettait de la musique. Il posa sous le saphir, un vinyle de Carl Orff. La musique propulsée dans son casque de chevalier l’accompagnerait dans sa quête, comme une écuyère. Elle lui racontait comment un peuple luttait pour se sortir d’un monde qu’il avait lui-même engendré.
Dans la bibliothèque, il se mit à parcourir, les titres de tous les ouvrages alignés sur les étagères. Une lecture effrénée pour retrouver ce livre qu’il était certain de posséder. Ses mains couraient sur les reliures à en faire vaciller les bibelots intermédiaires. Une petite statuette ramenée de Grèce faillit s’éclater en tombant. Il reconnut dans ce signe la protection des philosophes antiques. Sa quête s’engageait sous les meilleurs auspices.
Quand il eut trouvé le recueil, il s’affala dans le fauteuil, face à la cuisine. Il savait que son itinéraire initiatique du jour passerait par là. Mais il lui fallait penser chacun de ses pas et de ses gestes pour y parvenir sain et sauf. Le chapitre huit du livre de Sun Tzu offrait l’arsenal intellectuel le plus percutant. Il se mit à lire à satiété, puis survola le reste pour ne pas prendre le risque de rater une information capitale. Une fois achevé, il replaça L’Art de la guerre, à sa place. En cet instant précis, il savait comment atteindre son objectif. Il se sentait prêt à affronter tous les défis.
Et le voilà rédempteur des causes perdues. Le défenseur des faibles et des opprimées. Un courage qui lui procurait des sensations inédites. Mais onze heures tintaient à la pendulette empire. Il avait consommé déjà de précieuses réserves de temps.
Du salon, son regard se heurta au placard. Il savait qu’il y trouverait là, les armes pour affronter le monde nouveau.
Vers 12 h, le temps était compté désormais. Elle ne rentrerait, qu’après un détour au centre-ville. Cela lui laissait une petite demi-heure pour agir. Il se sentait un courage immense. Une témérité à la hauteur de l’enjeu.
Et ainsi, gonflé d’ardeur et prêt à changer le monde, il traversa le vestibule, avec une dernière pensée pour sa femme affichée sur le mur. C’est aussi pour elle qu’il se devait d’agir ; pour elle et leurs enfants. Le temps n’existait plus. Il visait l’éternité, même si la pendulette le pressait à s’accomplir sur-le-champ. A la fenêtre, la lumière du jour étincelait.
Il se planta d’abord, devant le placard et empoigna les instruments nécessaires au sacrifice. Puis, tel un droïde, il progressa mécaniquement vers la cuisine. Là, il avisa une petite porte. Une petite porte de hêtre lasurée. Cette frontière anodine, qui s’ouvrirait sur l’inconnu, le champ des possibles, le creuset fou de toutes les folles espérances. Il la poussa d’un geste sûr, et, armes en main, se glissa dans la petite pièce sombre. Il l’illumina d’une pichenette sur l’interrupteur. Le néon éclairait le réduit comme un bloc opératoire. Sans concession, sans volupté, sans compromission. Cela lui allait bien. Finis, les petits arrangements avec la morale, terminé le déni sur l’avenir de la planète, effacé le confort machiste, éradiquée la bien-pensance du politiquement correct.
Le brave quinquagénaire n’était plus qu’à deux doigts de franchir le pas vers une seconde vie. L’heure approchait, fatidique. Il ne lui restait que quelques minutes pour révéler au monde, à Elle, et à lui-même, cette créature nouvelle. La métamorphose tant espérée allait-elle se produire ?
Il ignorait la chorégraphie des gestes, et cependant les reproduisait d’instinct, comme s’il avait toujours su. Dans la folie de l’instant, il se voyait inquisiteur, avec ses fers rougis à la braise. La chaleur montait, et toute humidité se vaporisait, suffocante.
Il déplia la table aux pieds de métal gris, y étendit une enveloppe amorphe de lui-même, et y apposa le fer brûlant. Le tissu réagit moribond, en se dépliant, abandonnant toute résistance. Et dans une étuve infernale, la plaque incandescente passait et repassait, annihilant toute ride et tout pli.
En accomplissant ces gestes, il réalisait un acte refondateur. Il n’était plus le même. Tout avait changé. Rien ne serait plus comme avant. Nul ne vivrait comme avant. La terre avait pris une autre orbite, et l’humanité ne pouvait que s’aligner, pour la félicité éternelle.
En ce samedi de mars, à 12 h 22, et après des années de conditionnement et d’internement, notre homme, enfin, repassait seul, sa chemise.
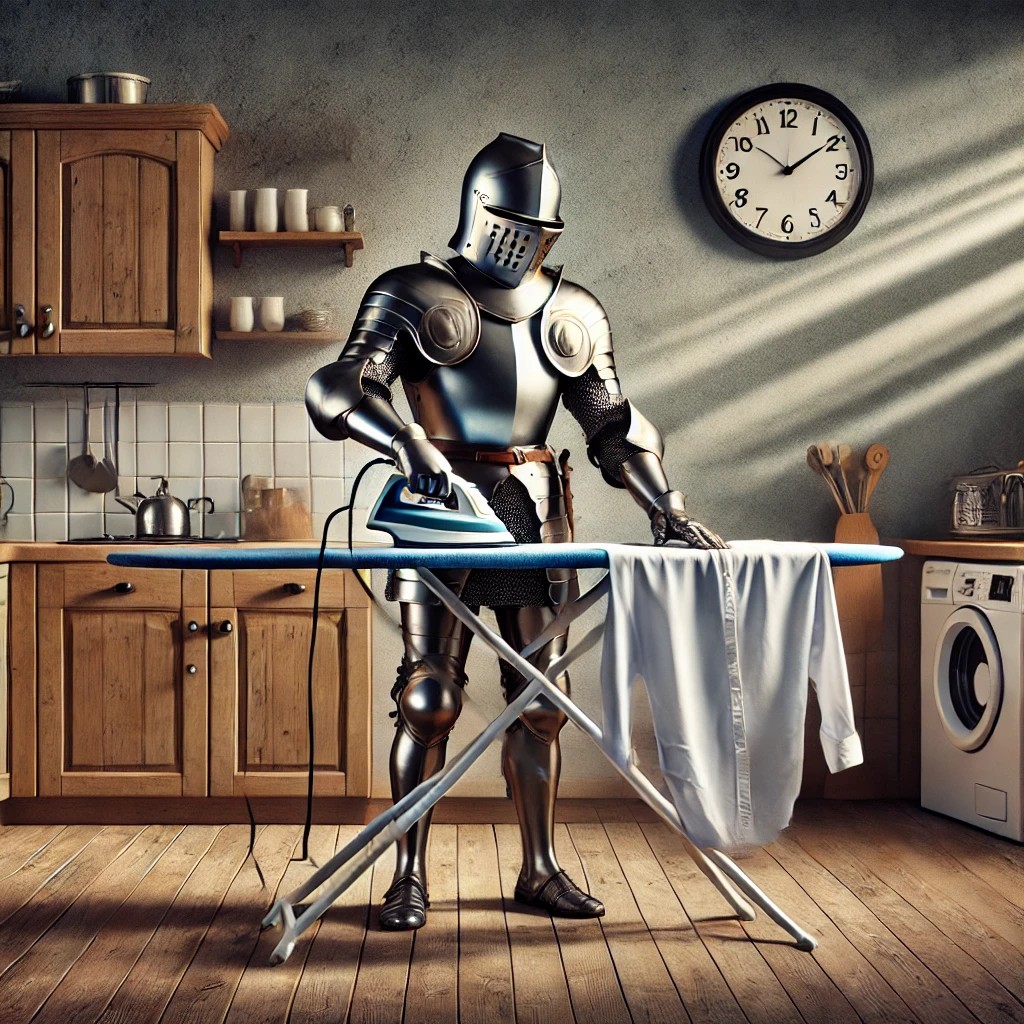

L’arbre d’hier
Un héritage inattendu, un arbre majestueux, et un lien profond entre passé et avenir : une histoire de mémoire, de sacrifice et de renaissance.

Les moustiques du Tombolo avaient presque eu ma peau. J’avais choisi la plage pour gagner la presqu’île, en souvenir de mes étés d’enfance. Mais aujourd’hui, rien d’insouciant dans ce voyage. Au bout de la marche, m’attendait un vieux notaire de famille.
En arrivant à l’étude, toutes les voitures familières étaient là. Et en effet, lorsque la secrétaire m’introduit dans le bureau, mes cinq cousines et cousins s’impatientaient. A mon allure détendue, ils perçurent très vite mon dilettantisme décalé, dans ce moment, pour eux si solennel. La tension augmenta d’un cran, quand l’officier déplia le testament de ma tante.
Veuve depuis quelques années déjà, elle était partie seule, gérant malgré l’âge, un patrimoine des plus cossus. Je crois que de son vivant, rares ont été les occasions pour les enfants de se réunir. Ils ne lui ont pas offert ce bonheur. Elle aurait tant aimé, pourtant.
A mots pesés, le notaire acheva sa lecture du testament. L’énoncé sembla satisfaire chacun des héritiers. Tout y passa : du portefeuille d’actions, aux appartements parisiens, en passant par les voitures italiennes, et surtout « L’Aurada » ; la grande propriété de la presqu’île. Cela semblait équitable à un détail près. Un détail qui justifiait ma présence intruse.
Ma tante honorait une promesse faite à son feu mari. Avant de mourir, le vieil homme tenait à me réserver la pleine jouissance d’un petit terrain, sur lequel était planté un arbre magnifique, aux confins du parc. Le « lopin » était suffisamment grand, pour permettre à ce grand végétal, une saine croissance, tant de sa frondaison, que de ses racines. Au final, cela représentait une large bande face à la mer. La disposition singulière faisait naître deux servitudes. La première m’incombait, puisque, selon les dernières volontés de mon oncle, je devais veiller à l’entretien régulier de l’arbre, et le protéger de toute menace. La seconde concernait une de mes cousines. La nouvelle propriétaire de « l’Aurada », devait accepter que je traverse sa propriété, pour me rendre sur le terrain.
Dès la semaine suivante, je me rendais sur place. La ramure s’agitait, magnifique, dans la brise méditerranéenne. Le tronc vertigineux s’estompait dans l’azur. C’était une essence qui, loin de redouter les alizés, se nourrissait d’iode et de soleil. Sur le sol, peu d’espèces pouvaient croître dans son ombre. Je m’approchais de l’arbre, et m’assurant d’être seul, me mit à lui parler pour la première fois.
J’entrepris de lui raconter toute l’histoire, ainsi que notre destin commun désormais. Ses feuilles bruissèrent ; mais ce n’était qu’une pie, qui prenait son envol. En prenant congé, je jetais un dernier regard déférent à cet être majesté.
Durant des années, je revins régulièrement, comme j’en avais fait la promesse. Entretenir la parcelle ne me posait pas de problème : quelques élagages légers, un peu de ratissage, et une inspection minutieuse des parasites susceptibles d’altérer la survie de mon arbre. Il était fréquent d’apercevoir de beaux insectes, ainsi que des petits passereaux, qui formaient ici un petit monde de diversité. Cependant, je ne croisais qu’en de très rares occasions les occupants de la résidence, qui s’ingéniaient à m’éviter. D’ailleurs, je n’en revis aucun des cinq, trop affairés à la gestion de leurs affaires. Le clan semblait m’ignorer. J’appris indirectement qu’ils éprouvaient à mon encontre une certaine jalousie, voire une convenable détestation.
Le lien que j’avais avec mon oncle, s’était forgé dès ma petite enfance. L’adolescence nous avait encore plus rapprochés. Mes goûts pour la peinture et la littérature y étaient certainement pour quelque chose. L’été, j’écourtais des après-midi de plage, pour le rejoindre. Nous devisions, confrontions nos idées, et peignons nos émotions sur des chevaliers, dressés dans le parc. Je me souviens avoir croqué à plusieurs reprises avec lui, l’endroit qu’il me légua plus tard. Cet homme était la bienveillance incarnée. Et je me retrouvais dans cet esprit de tolérance, dans cette faculté à nous extraire du quotidien pour réfléchir au sens des choses, et à la profondeur des évènements. Ma tante nous rejoignait parfois, lorsque sa vie de mère lui en laissait le loisir.
Avec le temps, l’arbre est devenu un confident. C’est un peu comme si je parlais à mon oncle. Je lui confie les épreuves de la vie, les espoirs, les enthousiasmes, et mes amours. J’y reviens maintenant une fois par semaine. Vous pourriez m’y rencontrer tous les samedis. Nul ne peut prétendre, que je ne tienne pas mes engagements. L’arbre me le rend bien, par son ombre, par la fraîcheur qu’il dégage, et par la force qu’il m’inspire. J’ai avec moi tout un petit outillage de jardin qui me permet d’assumer l’entretien du terrain. J’ai même installé deux ou trois fauteuils de jardin, afin de siroter une bière sortie de ma glacière. L’hiver est moins propice, même s’il fait doux ici. Surtout l’imparable vent, quelle que soit la saison, et quel que soit le temps.
J’ai entendu des cris quelques fois, venant de la maison. Le climat se dégrade semble-t-il. Il y a une dizaine d’années, j’ai appris du notaire, qui s’ouvre à quelques indiscrétions, que ça tiraillait un peu entre les cousins. Je comprends mieux depuis, la haine dans leurs yeux, quand je les croise dans le centre-ville. Cela dure un instant, juste le temps qu’ils changent de trottoir. Et par confidences, j’en connais davantage sur la situation. Dans mon cercle amical, il était de notoriété, que les héritiers avaient dilapidé leur part d’héritage, avec la saisie des appartements de Paris, des opérations boursières douteuses, la perte des voitures. Et surtout la vente de la propriété familiale. J’ai encore de l’affection pour eux ; nous avons tant partagé, étant enfants. Mais les adultes qu’ils sont devenus méritent leur sort. D’autres sont plus à plaindre. Je ne leur en veux pas, même s’ils font pression sans cesse, pour que je restitue mon bout de terrain, qu’ils considèrent comme un dû.
Les nouveaux propriétaires sont plus conciliants. Nous nous sommes arrangés pour ne pas nous déranger mutuellement. Il faut vous dire que je suis à l’Aurada tous les jours. Je n’habite pas la grande résidence pour autant. J’y ai ma propre maison. Il faut que je vous raconte.
Il y a deux ans, j’étais amoureux comme jamais de celle qui allait devenir ma compagne. J’avais, comme toujours, partagé ces émois secrets avec mon arbre. « Nous » avions parlé projets, comme seule la passion le permet, sans limite et sans raison. Je lui avais confié notre désir tout simple de fonder une famille, de trouver un terrain pour y construire notre maison, et des difficultés de l’immobilier sur la côte. Mon arbre comprenait autant les élans du cœur que les préoccupations du quotidien !
Un an plus tard, malgré mes soins, l’arbre se dessécha. Je compris avec émotion, qu’il se laissait mourir pour nous offrir, une fois dessouché, un terrain propice et suffisant pour y bâtir notre petite villa, face à la mer.
C’est de la terrasse que je vous écris, lectrice et lecteur. Marie est à mes côtés perdue dans sa lecture. Derrière nous, si vous regardez bien, dans l’angle de la pergola, un berceau attend, à l’ombre d’un jeune plant. Une graine de mon arbre y a trouvé refuge, pour que le souvenir de mon oncle continu à protéger notre bonheur.


Nu
Un matin, il choisit de tout quitter, même ses habits, bouleversant l’ordre établi.

Ce matin-là, je décidais de ne pas m’habiller. De ne plus me vêtir.
Comme beaucoup, je dors nu, et, en temps normal, je prends mon déjeuner comme ça, jusqu’à ce qu’au sortir de ma douche, je revête mes habits de bonhomme de bureau. Mais aujourd’hui, je n’en ai pas envie. Je veux rester libre de mes mouvements, et après tout, me montrer comme je suis. Ni pire, ni mieux qu’un autre. Un mec. C’est tout. Et (ce n’est pas pour dire), mais on était en juin. Et objectivement, en y repensant, je n’aurai peut-être pas pris la même décision en février. Mais bon, c’est comme ça. On était le 18 juin, et l’appel du général n’était pas forcément une coïncidence. On ne soupçonne jamais assez le pouvoir subliminal de France info le matin, quand on émerge à peine de sa nuit. Le fait est là : ce matin, je me pointe à poil au bureau.
Je travaille au siège d’une compagnie d’assurance. Autant vous dire, que le dress code est assez rigide. Mais ma réelle appréhension, pour le moment, ne se situait pas à la Défense. C’est pile-poil quand je tournais le verrou pour sortir sur le pallier, que ça m’a pris. En me voyant, comme ça en tenue d’Adam, dans le miroir de l’entrée, le sboub pendant, avec mon portable sous le bras, l’air sérieux du type qui feint de ne pas se sentir ridicule, que j’ai explosé de rire. Quel con ! Et c’est avec ce sourire de malice, que j’ai refermé la porte de l’appartement. Je m’amusais moi-même de moi-même. C’est déjà ça. Mais bon, les autres seraient-ils aussi sensibles à l’humour de la situation. Je n’en étais vraiment pas certain.
J’atteignis l’entrée du métro facilement. C’est à 50 mètres. J’ai bien croisé le regard de quelques passants, mais je fonçais m’engouffrer dans l’escalator sans prendre le temps de capter les commentaires que l’on faisait derrière moi. La cohue du matin me dissimulait aux caméras de quai, et dans la voiture, serrés comme des maquereaux, je m’agrippais à l’aluminium, au milieu d’un petit groupe masculin. Les femmes m’avaient bien vu, et avaient jugé bon de s’éloigner, de ce qui devait leur apparaître comme un malade, voire un sadique. Dans ma tenue, j’étais certain de ne pas attirer de pickpockets. Cette pensée me fit sourire à nouveau.
Dans un flot de reflux, je suivis le courant des passagers descendants, qui jaillirent en masse, sur le parvis des immeubles. Ça jasait de partout. Les gens déviaient de leur trajectoire habituelle, et tel le mage et la mer Rouge, le chemin se traçait face à moi, en laissant de côté des mecs qui se marraient. Deux vigiles de la tour B, se mirent à courir vers moi en gueulant tels des chiens policiers. Je forçais le pas et pu leur échapper en pénétrant dans le hall de marbre de la Compagnie Suisse de bancassurance. Les hôtesses n’eurent pas le temps de refermer la bouche, que d’un coup de badge, l’ascenseur me montait au troisième.
Je n’avais jamais remarqué comme la moquette était douce sous la plante de nos pieds. À pas de velours, je progressais jusqu’à l’open space. J’étais un chat ce matin. Un chat du Mexique.
Les personnes agglutinées autour du distributeur de café, m’avaient suivi sans discrétion, et écrasaient leurs bouilles sur la baie vitrée, pour mieux comprendre la situation. Dans l’espace de travail, les collègues semblaient interloqués. Je faisais mine de rien, saluais d’un coup de tête chacun d’entre eux, et ouvris la session de mon ordinateur, pour démarrer ma journée, comme d’habitude.
Au bout d’un court temps, Stéphane me demanda ce qui se passait, si j’étais mal. Je voulus lui répondre, mais la DRH poussa la porte, et m’intima de la suivre sur-le-champ.
L’inédit de la situation la perturba. Un entretien, peut-il être sérieux quand le salarié est à poil ?
Elle me regarda, comme ça un long moment, comme pour se délecter d’une situation hors norme, qu’elle ne rencontrerait peut-être plus jamais, dans sa carrière de manageuse. Je ne disais rien jusqu’à ce que j’éprouvasse le besoin de lui adresser un « quelque chose ne va pas ? ». La surprise la désarma et elle partit dans un fou rire incontrôlable. Et pendant qu’elle riait, je tentais de lui apporter des éléments objectifs, susceptibles de la ramener à son rôle et à son statut. Je lui parlais de liberté, d’envie de vivre, d’abolition des convenances, de ras-le-bol des dogmes que nous impose la société, de qualité de vie au travail, de respect des personnes et de lutte contre les discriminations. Après tout, ce qui importe au travail, ce sont les compétences, rien que les compétences. Peu importe que le salarié soit foncé de peau, ou la salariée musulmane. Nous restâmes presque la matinée à échanger. On sentait derrière les parois du bureau fermé, l’agitation de tout le peuple du troisième étage. La journée ne serait pas propice à la productivité.
Vous vous demandez comment cela s’est terminé ? C’est bien normal.
Et bien, vers midi, j’ouvris la porte du bureau pour sortir le premier, et me diriger vers la lueur de l’écran de mon pc. Et dans mes pas, la Directrice des Ressources Humaines de la Compagnie Suisse de bancassurance de la Tour C de la Défense, en fit de même, totalement nue.


Oëtre, ou ne pas être
Dans les gorges de la Rouvre, deux âmes marquées par le temps se croisent, trouvant dans la nature et le silence une étrange harmonie entre passé et présent.

Je suis revenue au village, avec fatalité et espoir. Passé soixante-dix ans, le temps m’entraînait comme un courant rapide. Saint Philibert n’avait guère changé, mais quelque chose en moi était prêt à renaître. Je ne cherchais pas à fuir. Plutôt à m’abandonner à quelque chose qui, depuis longtemps, sourdait en moi, indéfinissable. Une partie que j’avais laissée en suspens, en alerte, sans vraiment comprendre pourquoi.
Les gorges, là où la Rouvre serpente avec une inépuisable obstination, imposaient leurs découpes sauvages et primitives. Le minéral s’élançait vers les nuages avec la même rudesse qu’autrefois, et, en observant les à-pics, je sentais que mon âme elle aussi, malgré la vie, se cambrait encore avec fougue. La roche nue, avec ses fissures et ses fractures, résonnait en moi comme les cicatrices d’une femme marquée, mais toujours debout. Le corps change, bien sûr, mais il se déploie aussi d’une manière nouvelle, tout comme la terre elle-même s’adapte aux mouvements invisibles qui la façonnent.
Dès que je le pouvais, je m’évadais. La marche pousse à aller vers autre chose. Un ailleurs qui tient de la découverte, du pittoresque et de la méditation. Les sentiers que je parcourais, s’enfonçaient dans les bois, comme des veines de sève sous une écorce ancienne. Cette nature retrouvée me préservait, douce et indomptable. Le clapotis de la rivière, en contrebas, n’était jamais loin ; un battement régulier, profond, en résonance avec mon propre souffle. L’eau courait librement, sans hâte, creusant son chemin de patience dans la roche. Comme elle, j’avais suivi mon cours, sans urgence, érodant ma vie jour après jour.
Ce soir-là, ma balade s’achevait en s’agrippant aux lambeaux de lumière de fin d’après-midi. Parvenue sur la crête, je longeais le bord du précipice. Le promontoire offrait une vue toujours inouïe sur l’abîme. Le vertige s’engouffrait dans mes cheveux. Chaque rafale de vent ravivait mon instinct de ne pas craindre le vide. C’est là, sur un chemin détourné, que je l’ai rencontrée. Edna. Elle se tenait un peu plus loin, immobile, absorbée par le paysage, comme si elle appartenait à cet endroit, à cette lumière dorée qui effleurait la cime des plus hauts arbres.
Je n’aurais pas su dire son âge. Sa silhouette évoquait l’intemporel, une force tranquille qui contrastait avec la fragilité apparente de son corps. En m’approchant, je discernais son visage que le temps froissait à peine, tels les draps d’un lit où l’on s’est juste assoupie sans le défaire. Ses yeux brillaient d’une lueur intense. Un éclat qui semblait naître des profondeurs mêmes de la nature environnante. Il y avait dans sa posture une tranquillité rare, une présence apaisante, granitique. Je l’abordais.
Nous avons échangé quelques mots, d’abord sur la beauté du lieu, sur cette lumière changeante partagée en silence. Une conversation plus profonde s’est ensuite tissée entre nous, comme ces rus discrets qui gagnent sans bruit la rivière. Edna, comme moi, avait trouvé refuge dans ce coin perdu de Normandie, attirée par les charmes secrets de ces paysages, qui révèlent quelque chose d’enfoui en nous.
Je me suis laissé porter par cette proximité naissante, par cette complicité discrète qui s’installait entre nous. Au fil du temps, nous avons pris nos habitudes. Les jours passaient, et nous nous retrouvions sans vraiment planifier, d’instinct. C’était comme si la terre elle-même nous guidait l’une vers l’autre, comme si nos chemins prédestinaient à se croiser sur ces sentiers terreux, dans cet entrelac de bosquets, au bord de ces ravins, qui nous appelaient sans cesse à regarder plus loin, plus profondément.
Les paysages que nous traversions reflétaient étrangement nos conversations. Les horizons éveillaient en nous des souvenirs enfouis, des espoirs que nous n’avions jamais formulés. Il y avait une fluidité dans nos échanges, comme le flux qui glisse doucement sur les pierres, imprévisible et pourtant constant. Chaque mot, chaque regard partagé creusait en moi un chemin exaltant, révélant des émotions que je pensais avoir oubliées, ou simplement abandonnées. Sous les frondaisons denses, dans la lumière tamisée du bocage, je me sentais à nouveau jeune, entière, éveillée.
Edna parlait peu de son passé, et je n’en disais pas davantage du mien. Ce n’était pas nécessaire. Nous étions là, dans cet instant suspendu, comme deux êtres en osmose avec la nature environnante. La sensualité de cet air saturé des parfums humides de la terre et des sous-bois, s’immisçait dans nos échanges. Un bruissement de feuilles, le frôlement du vent sur ma peau… tout prenait une nouvelle signification. Les caresses de la nature se mêlaient aux silences que nous partagions, aux gestes légers, aux sourires esquissés.
Un jour, notre fatigue s’est assise au bord de la rivière. Un petit renfoncement discret, agencé de grosses pierres et de graminées. Tout respirait le calme et le délassement. Côte à côte, nous avons plongé nos pieds nus dans l’eau fraîche et paisible de cette alcôve, fermé nos yeux, et offert nos visages à la douceur du soleil. Je la sentais près de moi, percevais sa respiration éthérée qui se synchronisait avec la mienne. Nous ne faisions qu’une. Et dans l’aveuglement de l’instant, j’ai senti sa main, prendre la mienne avec une tendresse infinie. Je n’ai rien dit. Sans lever nos paupières, nous nous sommes blotties l’une contre l’autre, en communiant nos sens. Pour moi, la fin de la longue hibernation de ce qui relevait, dans ma jeunesse, d’un sensuel feu follet. Puis, sans rien décider, simultanément, nous avons rouverts nos yeux, comme pour partager avec le monde, ce délicieux moment volé à nos histoires. Chacune scrutait un lointain qui, par le rebond sur une cime, une crête, un nuage, se reflétait en nous, dans nos esprits, nos cœurs et nos entrailles. Pour savourer l’instant ou redoutant une amertume coupable, nous n’osions croiser nos regards. Dans le silence d’une nature grouillante de sons de toutes parts, nos yeux vagabondaient sur ce décor de pierre et d’eau. Et puis, soudain, en mirant l’onde calme, dans le reflet, j’ai vu qu’elle me fixait. L’échange muet dura ; troublant, intense. Au creux de nos failles, la rivière racontait pour nous, le flot de nos émotions, et de nos sentiments en cascades. Plus haut, surplombant la gorge, un couple heureux de buses virevoltait.
Nous n’avons jamais parlé de ce moment par la suite, ni de ce que nous avions ressenti. Il n’était pas nécessaire de le dire à haute voix.
Depuis, Edna et moi continuons à marcher ensemble. Il n’y a pas de promesse, pas de futur à dessiner. Juste ce présent que nous habitons pleinement, chaque pas résonne avec la terre sous nos pieds, chaque souffle avec la brise qui nous caresse. Le temps, à Saint-Philibert, semble couler différemment, comme si les gorges, avec leurs ravins et leurs falaises, se jouaient des horloges humaines. En compagnie d’Edna, je n’ai plus l’impression de le fuir ou de le combattre.
Peut-être que le plus grand secret réside là, dans cet espace entre la roche et le ciel, entre la terre et l’eau, où la vie, toujours, trouve son chemin.


Viatique antique
Dans une étrange boutique d’antiquités, un homme explore les méandres de sa mémoire, guidé par une présence énigmatique… jusqu’à une révélation bouleversante.

« Bienvenue dans ma petite boutique ! Vous avez fini par la trouver. Il faut déjà la dégotter, dans l’entrelac de venelles de ce cerveau historique. Aller. Entrez, entrez. Je vous laisse musarder, au gré des étagères qui regorgent de trouvailles ; et ne vous inquiétez pas. Je viendrais en cas de besoin. Je suis votre âme. »
C’est à ça qu’elle ressemble, mon âme ? Et la vôtre ? C’est vrai qu’on la sent parfois s’agiter, mais voir son visage, reste peut-être le privilège des derniers instants. Pourtant, elle vient de disparaître, discrète, derrière le rideau de l’arrière-boutique. Un petit cervelet bien agencé, avec de quoi se préparer quelques en-cas, ou piquer un petit roupillon. Un petit écran bleuté reste en veille, sur ce qui se passe au-delà.
Resté seul dans la brocante, j’hésite à prendre une direction dans ce capharnaüm. Ça me rappelle… Ça me rappelle… Bah ! Je ne m’en souviens plus.
« Vous avez besoin d’un conseil ? » L’âme vient de surgir à mon côté.
« Je ne sais pas par où commencer, tant il y a d’objets et de salles. »
« Je vois. Comme lorsque vous vous êtes perdu en forêt ? »
« Oui, c’est ça ! À Vigezzo. J’avais 6 ans. Je me suis retrouvé seul, après avoir suivi le chien qui s’était enfui. J’entendais bien les appels lointains de mes parents, mais entre les bosquets, les taillis, les sentiers de renards, et la multitude des grands arbres, je ne savais plus où aller. »
« Et comment vous en êtes-vous sorti ? »
« Ça a duré longtemps. J’ai beaucoup pleuré ; je me souviens. Et puis j’ai aperçu un geai qui chantait, tout heureux sur sa branche. Ça m’a donné confiance. Quand il s’est envolé, je l’ai suivi. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il m’a montré le chemin. Et j’ai plongé dans les bras de ma maman, à me noyer dans son insondable océan d’amour. »
Un ange passe dans un silence duveteux. Puis mon hôte tend le bras. « Je vous laisse continuer la visite. Et si j’étais vous, je prendrais la direction de ce vieux coucou de Forêt-Noire. » Et pile, la petite bestiole de bois se met justement à jaillir.
Le son du carillon rythme les déploiements répétés de son ressort. Un tintement à la fois mécanique, mais si bienveillant. J’aurais voulu qu’il ne s’arrête jamais. Mais à 4 heures de l’après-midi, c’est 4 cloches. Pas plus. L’horlogerie, c’est la précision ! Je n’en ai que faire.
Je m’approche de la kuckucksuhr ciselée. Puis, ayant pris soin que personne ne me regarde, fais tourner les aiguilles de l’index. Et de nouveau, le coucou se met à scander l’heure, que je lui impose.
« Mais que faites-vous là malheureux ?» L’âme troublée est de nouveau ressortie de son gourbi, un peu contrariée. « Vous ne pouvez pas changer le temps comme ça ? »
« Pardon…C’est… C’est… Vous savez il y a des choses comme ça, qui ne s’expliquent pas. Je n’ai pas pu résister à le réécouter. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit m’évoquer, je ne sais quoi. »
« Quelque chose d’agréable plutôt, j’imagine ? »
« Attendez, attendez… C’est un truc de l’adolescence, j’en suis sûr. Je l’ai déjà entendu à Novara. C’est là qu’on habitait dans ces années-là. »
« Tâchez de vous remémorer, bon sang. Faites un effort. » L’âme semble pressante et un brin vexée. Après réflexion, je me dis que, pour une vielle âme, les années de jeunesse en constitue forcément le cœur.
Comme mon souvenir reste ballant sur le quai de l’exactitude, la boutiquière prend les choses en main : « Je vais vous aider. Voyons, pensez à des instants doucereux… Vos copains… Vos copines… Votre amour secret… Les cours… Et surtout la fin des cours… »
« Oh, mais oui. Mais ça y est ! C’était la sonnerie du lycée ! Oh, merci, merci, merci. Oui, c’était le signal pour la rejoindre. Nous ne vivions que pour la fin du cours. Ces battements semblaient s’aligner sur ceux de nos cœurs, avec la promesse de nous libérer chacun de nos entraves, pour nous fondre en une communion absolue et toute romantique, de nos corps. »
« Une communion des âmes aussi… » ajoute-t-elle avec un rictus genré. Puis elle me laisse seul, à savourer le moelleux souvenir nimbé du sucre glace qu’est la jeunesse.
Par association d’idées, mon regard se pose au loin, sur une bonbonnière africaine. Ma grand-mère en avait une, sur son bahut de bois de fer. Ils avaient fait les colonies, comme on disait à l’époque, et en avait rapporté toutes sortes d’objets exotiques. Cette boite en bois sculpté racontait, sur son pourtour, des histoires de village. Mais le vrai voyage était moins exotique. Il suffisait d’attendre d’en avoir la permission, pour dévisser le couvercle, et y glisser nos menottes. La confiserie était bien banale, mais sa saveur frôlait toujours l’exceptionnel. Même vide l’odeur persistait, tant le bois en était imprégné.
J’espère retrouver cette exhalation, en ouvrant la boite du magasin. Mais rien ne transpire, que la frustration de perte irrémédiable de ce parfum enivrant de l’enfance.
Un bruit de porte me ramène à la réalité. Un vieil homme vient de pénétrer dans le magasin d’antiquités. Il semble perdu, comme je l’avais été.
Il me rappelle quelqu’un que j’ai déjà vu. Où nous sommes-nous croisés ? Le visage semble familier. Cette allure voûtée, cette calvitie, ces jambes légèrement arquées… En cet instant précis, je pense que l’âme viendra me secourir à nouveau, pour ressusciter des souvenirs encore enfouis. Mais elle ne vient pas. Que fait-elle ? Elle m’avait dit qu’en cas de besoin, elle serait là.
Impatient je m’approche alors du rideau du fond, et me glisse dans l’arrière-boutique déserte, elle aussi. La seule trace de vie est cet écran de caméra de surveillance qui capte mon attention. Elle est braquée, fixe, sur le seuil. Je regarde bêtement un long moment. Et d’un coup, je reconnais ce vieil homme… Cette silhouette. Cette allure plus que familière : C’est la mienne ! Comment est-ce possible ? Comment puis-je me trouver simultanément dans ces deux endroits ? Pincez-moi ! Je rêve ou quoi ?
Soudain, fauché dans ma stupéfaction fatale, l’âme tapote mon épaule, rapproche son visage blafard, porte sa bouche à mon oreille, et me susurre sereinement :
« Il est temps de partir maintenant. »


Fleurs de nostalgie
Dans un jardin empreint de souvenirs, le temps, à la fois témoin et voleur, murmure ses histoires oubliées.

Des plantes présentes de mon jardin,
La plus épanouie, reste la nostalgie.
Hampes et racines y puisent vie,
Pour des jours-fleurs sans lendemain
La bêche exhume maints os orangés.
Un chien vivait ici, ces traces nous le disent.
Il n’en reste que ces restes rongés ;
Témoins d’un temps qui vampirise.
Un lambeau de corde pend encore au noyer.
Une fillette jouait ici ; ces traces nous le disent
Balançoire effacée de l’enfance oubliée ;
Rose vestige d’un temps qui vampirise.
Des palmiers bruissent dans l’humidité du vent.
Des graines plantées ici ; ces palmes nous le disent.
Elles viennent d’ailleurs ; de voyages d’avant ;
Chaudes exilées d’un temps qui vampirise.
Je rejoindrais un jour cette terre douce et noire.
Une femme vivait ici ; mes pleurs vous le disent.
L’amour gît, attendant pour renaitre la tombée du soir ;
Vains espoirs en couronne, du temps qui vampirise.


Préhistoire d’amour
Plongé dans la préhistoire pour une épreuve immersive, un étudiant échoue à maîtriser le feu mais découvre une humanité brute et fraternelle, bien plus puissante que la technique.

Mais comment avaient-ils pu accomplir ce prodige ? Je ne parle pas de la technologie à projeter les étudiants dans le passé, mais aux crédits gouvernementaux pour le faire ? En tous cas, la réalité était que l’Education Nationale Générative, venait de m’expédier au paléolithique, pour mon épreuve d’histoire immersive.
Le jury attendait des élèves, qu’ils parviennent à résoudre un problème, dans une temporalité qui n’était pas la leur. Il fallait alors mobiliser aptitudes et connaissances du programme pour proposer une solution.
Je ne sais pas si c’est mon goût pour l’art pariétal des tags, ou la façon de me bâfrer de mon bobun du midi, qui a inspiré à l’algorithme éducatif une épreuve en préhistoire. Ce qui est vrai, c’est que je me gelais, avec cette peau de renne puante sur le dos. J’ignore s’ils parlent climat à cette époque, mais le réchauffement climatique ne semble pas les préoccuper en période postglaciaire.
Ma mission consistait à faire du feu ; plus que ça : « Inventer » le feu. Je connaissais la grande guerre 14, les croisades…Mais je dois reconnaître, que j’avais fait l’impasse sur tout ce qui venait avant les pharaons. Et en plus, je ne fumais plus. Je dis ça, car si j’avais eu un briquet en poche, c’était plié. Mais pas de briquet…Et pas de pantalon non plus. Et pas trop le temps de geindre, car ça bouge par là. Combien sont-ils ? Sept, huit silhouettes pesantes sortent des taillis. Sur le pas de leur abri-sous-roche, je n’ose pas trop bouger. On dirait de grosses brutes voûtées et velues, mais leurs petits yeux noirs et intelligents me scrutent avec curiosité, plus qu’animosité. J’ai peine à identifier les femmes des hommes, à part celle qui porte un gamin accroché au creux de son épaule. J’ai l’impression d’être un homme-singe parmi les gorilles. Mais ils sont pacifiques et me détaillent sous tous les angles. De grosses paluches me tâtent et m’évaluent. J’ai tellement séché les cours de sport, que ma musculature ne peut leur inspirer de menace. J’ai même l’impression que le petit groupe me prend en pitié, tant je leur apparais inadapté à cette nature hostile et cruelle. Je ne crois pas qu’ils vont me bouffer (je me souviens que quelqu’un avait posé la question en cours.) Mais qu’est-ce qu’on en sait après tout ? Je chasse cette idée tout de suite, et repense au chrono. Du feu, faire du feu.
Le clan s’affaire pour la nuit. Il me laisse approcher, m’ignorant à moitié. Je les regarde faire, avec plein d’humanité. Un clochard n’aurait pas fait mieux pour survivre. Je les plains au fond, tant ils semblent démunis. La précarité du couchage se résume à une litière de fougère dans un recoin, où ils s’apprêtent à dormir tous ensemble. Dire que j’irais me plonger dans ce tas de fourrures cette nuit ! En attendant, leurs gros doigts pincent de petites baies qu’ils portent à leur bouche. D’autres rongent un os sur lequel pendent des lambeaux grisâtres. Certains mâchonnent des herbes ou des plantes. Un enfant m’en propose un bout, dans un geste lourd et brutal de solidarité. Je lui souris, et lui montre expressément que ce n’est pas de mon goût. Ça ressemble à une vieille feuille de salade, comme celle des hamburgers.
Au matin, j’ai mal dormi, dans la résonnance caverneuse d’un ronflement collectif. Mais, en m’extrayant de la mêlée, le froid me transit. C’est si facile de foutre le feu partout aujourd’hui. Un peu d’essence, un brixon et c’est bon.
Mais là rien de tout cela. Dans les Rahan que mon père avait conservés, le fils des âges farouche récoltait à son aise, du feu dans un arbre frappé par la foudre, ou en s’approchant d’un torrent de lave. Je n’allais pas attendre un orage improbable, ou m’élancer dans un périple hasardeux, à la recherche d’un volcan hypothétique.
L’aube pointe. La petite communauté s’étire en de bienheureuses pandiculations matinales. Le rythme de la journée s’installe mollement. Je vois bien, qu’à part chercher à manger, rien ne structure leur agenda d’aujourd’hui, tout comme celui d’hier, ou celui de demain. Il y a donc du bonheur à tirer, de ces journées guidées par la seule nécessité de survivre ensemble ; des heures errantes sans autre projet que débusquer de petits animaux, voire la dépouille d’une grosse bête, et chemin faisant, grappiller baies et champignons ; des moments de plaisir, à humer l’air du temps, sentir la douceur du soleil sur sa joue, se reproduire en grommelant, ou rire à gorge déployée, tous ensemble.
Deux bonnes heures s’étaient écoulées sans action véritable (Ce n’est pas parce qu’on n’envisage pas de lendemain, qu’on ne peut pas procrastiner.) Et puis, mollement, chacun s’affaire seul, ou en groupe. Près de l’excavation rocheuse, le cliquetis d’un homme assis en tailleur, attire mon attention. Je m’en approche prudemment. J’ai toujours appris à me méfier de la carrure des grosses brutes. Une mandale, et je ne me réveillerais jamais à temps pour la fin de l’épreuve. Le pire de mes cauchemars, en sorte. Il ne semble pas agressif, et me laisse même l’approcher par un grognement sympathique. C’est bien ce que j’imaginais. Il est en train de tailler un bloc de silex avec un os. Il a des gestes précis. Le process est minutieux, en dépit des grosses paluches. J’approche doucement ma main pour récupérer deux ou trois gros éclats de son débitage. Il est trop concentré dans la lame qu’il façonne, qu’il me laisse les prendre. Le partage ici, ne semble pas se négocier. Tant qu’il y a de la ressource pour tout le monde, inutile de perdre de l’énergie à se battre.
Dans mon souvenir, si je veux produire des étincelles, il faut cogner deux silex au-dessus d’un tas de mousse sèche. Je me pose à côté de l’homme qui m’ignore royalement, et me mets à l’ouvrage. Mes tentatives répétées durent longtemps. Sans succès. Ça doit marcher normalement. Pourquoi ça bug ? Et je réessaye…Et je frotte, et je tape, et je souffle…Mais rien. Toujours rien. Mon acharnement a réveillé l’attention. Et quand je lève la tête de ma piètre poignée de mousse, je m’aperçois qu’ils sont tous autour de moi. Je ne les avais pas entendu venir. La discrétion est une vertu dans ce monde de prédateurs. Ils me regardent avec étonnement, cherchant à comprendre ce que je suis en train de faire. Mais je me doute bien, qu’ignorant sa finalité, mon comportement doit leur paraître au mieux maladroit pour tailler du silex, au pire, complètement idiot. Je tente de me justifier, et avec une langue dont ils ne saisissent que la mélodie, je leur explique que je cherche à faire du feu ; que c’est pour eux. Pour avoir chaud la nuit, se protéger des dents-de-sabres (merci Rahan !), cuire leur bidoche. Ah, si j’arrivais à organiser le premier barbecue de l’histoire ! Ils verraient bien l’intérêt du feu, avec une bonne viande grillée, saignante à cœur. La nourriture a toujours rapproché les humains.
Personne ne semble piger. Alors je me démène à nouveau, pour démontrer ce que je tente de leur dire. La matinée se passe, et au fur et à mesure, leur curiosité s’émousse. Un à un, chacun repart à ses occupations plus ou moins précises. Certains me sourient avant de tourner les talons, d’autres me tapotent l’épaule ou la tête puis repartent. Il y a de la compassion à ne plus savoir qu’en faire. Mais maudits cailloux…Ce ne doit pas être comme ça que ça marche. Tant pis. Il est bientôt midi, et la machine va me ramener devant le jury.
Une femme est restée près de moi. Je vois bien, à son regard, que ses yeux se portent davantage sur mon visage, que sur mes mains endolories de frapper ces pierres des heures durant. Je sens bien que je ne la laisse pas indifférente. Elle s’est accroupie doucement, et par petits piétinements indicibles, vient se blottir contre moi. Ce contact est totalement fou. Sa fourrure sent fort la crasse et les fougères humides. Jamais une fille ne m’avait procuré ces sensations. Et pour cause ! Mais passé cette barrière morale et chronologique, je ressens la chaleur de son corps et la bienveillante attention qu’elle me porte. C’est dur de la repousser. Je ne suis pas celui qu’elle croit, et de plus, toute aventure serait fugace, vu le degré zéro de mon désir, et surtout le chronomètre de l’épreuve qui arrive à sa fin. Je me hasarde à lui caresser la joue, puis me dresse en sifflotant, lève la main pour saluer le clan, et m’écarte d’un air détaché pour retourner au lieu de mon arrivée.
La technologie est parfaite. Me voilà face au jury, dans cette salle si ingrate avec ses stores qui ne se remontent qu’à moitié et les radiateurs toujours froids. Ils sont trois. Deux femmes et un homme. Celui-ci m’interpelle :
- Alors, quel bilan faites-vous de cette évaluation histo-pratique ?
Je ne sais que répondre, car c’est un échec total.
- …Ben… Je n’ai pas réussi. J’ai pourtant essayé, vous avez vu. Regardez mes mains gonflées.
- C’est vrai. Confirme une examinatrice, d’un ton sévère. Vous n’y êtes pas arrivé. Vous étiez pourtant censé en connaître la technique. C’est dans votre programme cette année. Je vous invite à relire ce cours. Cela pourrait toujours vous servir. Elle souriait.
- Alors c’est fini ?
- Non, pas tout à fait. Dit la seconde femme. Que retenez-vous de cette immersion ?
Je ne vois pas où elle veut en venir, et improvise :
- Ces gens sont comme nous, mais avec des qualités qu’on a perdues. Si tout le monde pouvait se comporter avec fraternité, attention mutuelle, amour et solidarité, la planète s’en porterait mieux.
- Vous voyez, vous avez appris beaucoup de cette expérience, et avez démontré des qualités personnelles essentielles aujourd’hui. Alors bravo. Nous validons votre épreuve. Il sera toujours temps à l’humanité de maîtriser l’art du feu !


Ici et maintenant
Dans la montagne, un homme plonge dans une réflexion sur la vie, jusqu’à ce que son propre cycle devienne un écho éternel à la nature.

Évoquer sa mort est souvent tabou. Et pourtant, en parler, signifie que l’on est toujours en vie.
Il y avait dans la montagne un chemin familier. La maison que nous louions depuis des années était la dernière du village, qui lui-même était le dernier de la route. Le point de départ de maintes randonnées. C’est ce qui nous avait plu. Aussi, été comme hiver, nous flânions sur les pentes ensoleillées ou brumeuses, en contemplant le creux de la vallée, ou en plongeant dans le cœur des forêts.
Je suis seul maintenant. Mais j’y retourne toujours randonner. L’itinéraire a changé. Je connais par cœur les détours et points de vue, sans m’en lasser vraiment. Ce qui est différent, c’est le voyage méditatif que me procure l’excursion. Une manière de repenser à ma vie d’homme mûr sans être trop vieux. C’est fou comme les souvenirs s’accumulent sans distinction de saveurs. Il n’y a ni chronologie, ni classement. On peut repenser à une colère d’enfant, puis l’instant d’après, à l’endroit où l’on vient de cacher ses clefs, puis ressentir l’intensité d’un amour disparu, et enchaîner avec un café partagé autrefois au bureau.
Aujourd’hui est un jour ordinaire. L’hiver n’est pas installé tant qu’il n’y a pas de neige. Bâton en main, je passe le bachal, puis m’éloigne du village. La chapelle d’alpage est le dernier vestige de la communauté montagnarde que je viens de quitter. Je marche à pas connus. Le sentier ne me réserve plus de surprise. Il fait bon, même s’il fait froid. Un temps maussade, sans plus. Juste un soleil falot derrière les nuages d’altitude. Vers onze heures, il viendra caresser le flanc de la montagne paisible. Peu de chance de croiser âme qui vive, en ce jour d’automne. Les conditions ne sont pas réunies pour inciter les randonneurs. Je marche seul dans les dénivelés familiers. La nature est ce qu’elle est ; gorgée de vie ; imbibée d’harmonie. Tout semble immuable. Un cycle renouvelé entre Animal et Végétal, où chacun tient son rôle et sa place.
En avançant comme ça, à midi, je serais au gîte pour déjeuner. L’endroit est réputé. J’y retrouverais l’affable patron qui surjoue l’amitié, et la cuisine roborative de sa femme courageuse. Mais là, ce matin, je ne sais pas … Je n’ai pas envie de cette issue prévisible. Je ne veux pas de cet ordinaire.
À la deuxième cascade, il y a cette petite sente qui monte drue et fuyante ; un brin technique, et surtout d’une improbable fin. Cela ressemble davantage à un tracé de bêtes, qui descendent boire ou chasser entre les fougères. Au bout de la piste se tapissent peut-être des louveteaux dans une tanière rocheuse, où quelques sangliers se vautrent dans une bauge de fortune. Je m’approche pour considérer la difficulté de la pente. Un renard y a laissé quelques poils aux ronces basses. Ça monte sec. Personne ne prend cette direction en général, tout juste quelques probables chiens de chasse, la truffe au vent. J’ai besoin d’y aller. Quelque chose m’attire sans que je ne sache pourquoi. La pulsion n’est pas violente. Juste une vive attirance qui emplit mon esprit, et dégourdit mes membres. Je n’ai pas envie de raisonner. Je l’ai trop fait dans ma vie. Ma rationalité m’a toujours protégé, comme la carapace de la langouste préserve ses chairs tendres. Mais en cet instant, le barrage semble céder, libérant le flux de mes émotions. Une énergie refoulée qui m’assiste maintenant que je progresse dans l’étroit conduit végétal.
Je fatigue après un bon moment. Je ne pensais pas avoir autant de souffle pour cette ascension hasardeuse. Au premier méplat, je m’arrête. Une occasion de relever la tête jusque-là penchée sur les pierres, où s’ancre chaque pas. Une chute serait fatale. Personne à appeler, nul secours à espérer. C’est peut-être ça la vraie solitude. Être seul, est plus qu’être sans personne, c’est d’être seulement avec soi-même.
Assis sur mon rocher au beau milieu de la forêt, je perçois l’isolement dans lequel je me suis fourré. Isolement relatif, car la nature m’entoure de ses bruits et senteurs. Je me sens bien. Ni peur, ni froid, pas plus de détresse que d’euphorie. Et en moi, remontant comme un petit orvet de mes synapses argentées, l’idée s’impose : c’est maintenant. Maintenant et ici. Je n’avais pas anticipé ce désir immédiat. Je décidais de rester là. A vie. A mort.
Ma première quête était simple : recueillir dans sous-bois mousse et feuilles fanées, et ce faisant, repérer l’espace où j’allais m’allonger, à tout jamais. Une morbidité banale qui imprégnait tout mon être. Un dernier regard. Nulle autre présence humaine. En cet instant précis, de tous les organismes et éléments, j’étais le seul de mon espèce. Et dans la grande hiérarchie, je ne valais pas plus que ce pied de digitale en sommeil, ou ce mulot peureux tapis sous terre.
La paillasse est prête. Je m’étends. Que m’arrive-t-il ? Pourquoi suis-je ainsi étendu sur le sol humide ? Je ne cherche pas de réponses, mais d’autres questions. Car c’est en interrogeant que l’on s’approche des vérités. Dans ma position, mes yeux sont braqués vers le ciel au travers les cimes. Tout est gris. Je sens sur moi une pluie très fine. Quelques gouttes plus grosses s’écrasent au sol libérant un bruit étouffé dans les mousses. Les sapins qui m’entourent, forment de leurs branches dégarnies, un treillage sombre et inextricable. Comme hypnotisé, je préfère fermer les yeux. Mes oreilles prennent le relais de mes sens. Mille bruissements s’entremêlent, dans des distances incertaines. Un envol, un craquement, un petit écoulement, des cris…Tout me rappelle à la vie, quand ma destination est autre. L’harmonie générale m’invite à la rejoindre. Appartenir à cet espace et devenir la forêt.
Après une heure, l’ankylose engourdit certaines parties de mon corps avec une légère douleur. Quelques heures encore, et je ne ressentirais plus rien. Ma température se synchronise tout doucement avec celle extérieure. Une hypothermie qui ralentit mes fonctions vitales. Même mon cerveau manque d’irrigation pour analyser avec pertinence, les étapes de ma décrépitude à venir. Je suis capable après une nuit, de raisonner encore. J’ai soif. La faim a disparu, une fois que mon organisme ait compris qu’il ne serait pas alimenté aux horaires biologiques habituels. Deux jours comme ça, et mon corps me fait mal. J’ai peine à graduer les douleurs. Mes reins me torturent, et provoquent des spasmes insoutenables. Ma raison déraille. Je vois, comme en rêve, mon passé se mêler à mes délires les plus insensés. Ma bouche est d’une sécheresse telle, que le moindre souffle doit se frayer un chemin dans les craquellements de mes muqueuses. Respirant à peine, je m’évanouis plusieurs fois, en perdant la notion du temps. Tout autour de moi, ça bruisse et s’agite. Le petit monde de la montagne, perçoit l’anomalie de ma présence, et les opportunités qui bientôt se manifesteront pour lui. Mon coma ne dure pas bien longtemps. Je suis bien au-delà, et continue à produire de la pensée. Suis-je encore vivant ? Mon cœur semble battre encore. J’arrive.
Il y a certainement eu un moment où j’ai basculé dans le trépas. Je ne m’en souviens pas. J’ai décompté les derniers battements de mon cœur. Suis-je mort maintenant ? Je ne suis pas triste. Une réelle sérénité me pénètre, au fur et à mesure que les degrés de mon cadavre s’éteignent. J’ai la température de la forêt maintenant. Un museau vient me flairer, puis repart. Ce sera le tour d’un corbeau plus tard, qui se servira de ma dépouille comme un promontoire.
Le temps passe, invariable. Mes muscles se relâchent un à un. La chimie prend le relais. Je m’adapte à cette nouvelle discipline, où la vie se poursuit sans notre volonté. Le calcium s’introduit dans mes fibres qui se raidissent. La fermentation des organes fait gonfler mon ventre, qui devient nourricier pour des millions de microorganismes. Je suis encore là, dans ces bactéries qui prolifèrent et me prolongent en une renaissance métamorphosée. Mon odeur a changé. Je dégage un fumet délicat pour les charognards de tous ordres. Je leur offre ma puanteur comme une gourmandise qui les maintiendra en vie, eux aussi.
Au bout d’un moment, mon corps verdi se relâche ; comme un abandon vers des étapes nouvelles. Ma peau se décolle, et laisse échapper les gaz qui s’animaient en moi. Mes cheveux gris se détachent et rejoignent les brindilles en un tissage incongru.
La vie s’écoule hors de moi, et des mouches viennent pondre à cette source minérale. L’orgie commence. Et de partout, achevant leur voyage, une myriade d’insectes arrivent pour participer au banquet. Le vent leur en a remis l’invitation il y a quelques jours déjà, et le trajet a été longs pour certains. Nécrophores, silphes, fourmis et acariens se nourrissent de mes fluides. Je passe d’un corps à d’autres, existant au travers leur destinée insignifiante. Mes orifices sont exploités comme les portes d’un palais ouvert aux émeutiers. Ils dévoreront mon corps noir et soufré avec méthode, jusqu’à ce que mes os apparaissent enfin à l’air libre.
Je semble remuer tant les asticots grouillent sur toute ma surface. Leur appétit est sans limite. Ils semblent ivres des fragrances nauséabondes que je produis par les déchirures de ma peau.
Les jours passent, et je suis toujours en place, sous une forme qui pourrait effrayer la promeneuse, mais qui ici et maintenant, rassure sur un printemps certain. Certaines parties de mon corps éclatent sous la pression des gaz, en soulevant quelques feuilles tombées sur moi. Tout en moi, devient liquide, jusqu’à mon cerveau bien inutile. Mais je pense encore. Comment est-ce possible ? Je suis heureux. Le bonheur de m’éparpiller en une nuée de petits animaux qui vont faire leur vie, une fois repus. J’imprègne le sol autour de moi. Je suis en symbiose avec l’humus, puis la terre, jusqu’aux racines des conifères et des bouleaux voisins.
Quelques semaines ont passé. Malgré la neige, je me dessèche. Ce qui me reste de chair colle à mes os. Je suis un parchemin que viennent parcourir, maintenant, d’autre insectes curieux. Mes mains et mes pieds se momifient. Je garde forme humaine. Suis-je encore un humain ?
Aux semaines succèdent les mois. Il y a encore de la matière vivante au début. Puis tendons, ligaments et cartilages se dégradent et se désagrègent. Mes os mêmes, sont devenus poreux.
Je subsiste en ce squelette grisâtre, qui, petit à petit se disloque. Des petits carnivores sont venus prendre leur part. Une louve m’a emmené, en partie, vers sa portée. Mais c’est bien moi. En morceaux. Même partiel, je forme encore une représentation de ce que j’étais dans votre monde de vivants ordinaires.
Combien d’années suis resté là ? Impossible à dire. Je me suis atomisé. Objectivement, je n’existe plus sur la surface de cette terre. Car je suis la terre. Mes os sont devenus poudre minérale. Ils fertilisent le sol au gré des saisons et du besoin des végétaux. Une partie de moi, a été absorbée par les racines de ce bouleau gracile. Je suis partout dans cette forêt vivante. Dans les feuilles et les fruits, les insectes, les oiseaux, les crottes du lièvre, les poils du chevreuil.
Un jour, des bûcherons ont débarqué à grands renforts de tronçonneuses et de tracteurs. Ils ont abattu les arbres qui se trouvaient ici, sans ménager mon souvenir.
Au gré des filières d’exploitation, certaines grumes ont rejoint l’usine à papier.
Et peut-être que je vis encore, dans les fibres de ce papier, dans le rectangle d’une feuille, dans les pages d’un livre. Ici et maintenant. Entre vos mains.


L’arbre nain
Récits oraux adalmayens, collectés, traduits et adaptés par la feue professeuse, A. Subdolo

Au pied de mon arbre, je suis le seul à voir le ciel tout entier. Nul branchage ne fait écran au firmament. J’entend le souffle des étoiles filantes. J’entends aussi les prisonniers de l’écorce.
Je suis, ce que l’on n’appelle plus, un nain. Mais ma difformité n’est pas là. Je vous en parlerai tout à l’heure.
Le Dieu Gnam
Tout débute dans le village de Glut, dans le cœur montagneux d’Adalmaï, une île oubliée du Pacifique sud. La vie y est pour le moins rudimentaire, voire assez frustre. Nous n’avons pas d’autre choix que d’exploiter, avec parcimonie, les maigres ressources de l’îlet « nourricier ». Pour vous décrire un peu l’environnement, disons qu’en dehors des tortues et des oiseaux marins, la mer, toujours démontée, nous interdit pêche et chasse. Entre les troncs, dans la forêt, nous cultivons un tubercule d’une essence qui vous est inconnue : le gnam. Nous en mangeons à toutes les sauces, si l’on peut dire : Gnam noix de coco, gnam fougère-autruche, gnam eucalyptus…Le gnam est notre âme. Sans lui, l’absence de vitamines nous anéantirait. L’arbre qui le produit, est vénéré depuis la nuit des âges. Le culte au dieu Gnam uni ainsi les clans, ceux des hauts comme ceux des flots.
Les rites doivent ressembler à d’autres religions pour ce qui est des chants, des danses, des transes et des palabres. C’est en tout cas ce que des naufragés ont pu nous dire avant d’être engloutis. Il existe cependant une pratique tout à fait singulière. La naissance de chaque Adalmayen, fille comme garçon, engendre la plantation d’un gnamier. Ce sera son totem, tout au long de sa vie. Mais le rituel ne s’arrête pas là. Pour que cela devienne un être sacré, l’arbre sera tailladé tout au long de sa croissance, de façon à produire des nodosités en grandes quantité. L’idéal est que le tronc en soit couvert, et apparaisse dès lors, le plus difforme possible. Quand vient le soir des cérémonies, la drogue aidant, chacun va retrouver son totem, pour une étrange conversation magique avec les dieux et les anciens. Sous l’effet des narcotiques, les nodules boursouflés ressemblent alors à des têtes hideuses, des corps démembrés, ou des visages crispés, figés dans l’écorce. Ces visions d’effroi, leur produisent autant de peur que de bonheur. Car c’est en côtoyant ces visions d’enfer, que l’Adalmayen mesure le sens de son existence. Il comprend qu’il y a pire que sa survie dans cette jungle frugale ; qu’il doit se satisfaire de ce qui le maintien en vie ; remercier Gnam de ne pas l’enfermer à jamais dans l’arbre des douleurs.
Sipho
Il y a longtemps, une femme mit au monde un petit garçon qu’elle prénomma Sipho. Comme la tradition l’exigeait, la famille planta un scion dans la montagne. Au même moment, il reçut sa première scarification. Celle qui est faite par la mère, comme pour dire à son enfant que Gnam l’aidera à supporter une vie de labeur et de privation. Puis tous allèrent se délecter de bière de rhizomes longuement macérés.
Bien vite, le développement de l’enfant intrigua. Le clan le regardait avec inquiétude et curiosité. Ses proportions n’avaient pas celles des bambins de son âge. Et au bout de quelques années, Sipho ne grandirait plus.
Il menait cependant une vie conforme aux nécessités, et comprenait très bien le monde ; peut-être mieux d’ailleurs que ses congénères. Depuis qu’il pouvait marcher, il partait seul, le pas allègre, dans la forêt. Comme tout le monde, il allait taillader son gnamier, qui bizarrement ne grandissait plus non plus. Était-ce juste l’emplacement, là, sous les trop grandes ramures qui ne laissaient passer qu’une portion congrue de soleil et de pluie ? Ou, comme certains le pensaient en secret, Gnam lui avait-il réservé quelque malédiction obscure ?
Sipho était aujourd’hui un homme. Il avait appris à se contenter des paroles chaleureuses d’une partie du clan, et mépriser ceux qui encore le raillaient sur sa petite taille. Il fournissait la même quantité de travail, et parfois réussissait même l’exploit de déterrer la plus grande récolte de gnams. Sa ténacité, son courage et son humanité avaient forcé le cœur de Themba. La jeune indigène vivait heureuse à ses côtés, gardant en elle la tristesse de ne pouvoir enfanter. Le Dieu malin s’immisçait-il dans leur bonheur qu’il jugeait contre nature ? Leurs deux arbres n’étaient pas très distants, et c’est ensemble qu’ils partaient leur infliger de nouvelles cicatrices. Themba adossait une échelle de bambou, pour parvenir aux dernières ramifications de la saison. Sipho, lui, se mettait à genoux pour inciser avec minutie le minuscule tronc de son frêle gnamier. En regardant bien, l’arbrisseau présentait autant de nœuds que les autres, mais en infiniment plus petit. Plus d’une fois, les pas de distraits le piétinèrent. Mais le végétal se redressait toujours. Il arborait maintenant une belle frondaison bleue.
Ce qui étonna tout le monde, c’est que lorsque l’arbre fut en âge de produire, ses tubercules se révélaient beaucoup plus gros, et beaucoup plus nombreux que d’ordinaire. On aurait dit qu’il gardait toute sa vigueur pour se développer…dans le sol.
Trouble-fêtes à Adalmaï
Procrastiner n’avait pas de sens là-bas. Chaque jour devait donner de quoi vivre jusqu’au lendemain. Ce n’est que les jours de la fête d’Adalmaï, que la tribu cessait toute activités agricoles. Si les cérémonies rituelles balisaient le calendrier mensuel, l’évènement festif n’avait lieu que tous les neuf ans. Rien au monde n’aurait su remplacer les célébrations. Durant des jours, les percussions, les piétinements frénétiques, les chants d’alégresse, les cris d’ivresse, les rires sonores, emplissaient tout l’espace. Les oiseaux désertaient l’île, et les quelques geckos se terraient, en attendant que la fureur s’estompe. Sipho et Themba s’y préparaient ardemment. La bière de gnam végétait, trouble comme il le faut, dans un fût de bois. Demain à l’aube, le son de la conque donnerait le signal. Mais au beau milieu de la nuit, elle réveilla tous les villageois, qui se regroupèrent sur les sommets d’où provenait l’alarme.
Une femme de guet affolée leur désigna dans l’axe du reflet de la lune, une armada encore lointaine. De mémoire d’Adalmayen, jamais autant de bateaux ne s’étaient approchés si près de leur territoire. Il arrivait bien que des fumées ou des voiles dépassent à l’horizon, mais jamais ils ne débarquaient. C’est à peine s’ils auraient pu apercevoir cette motte de lave bleue dans l’immensité de l’océan. Les forêts de gnamiers donnaient à l’île cette couleur qui, vu du large, la fondait au monde.
Au matin, les navires s’étaient considérablement rapprochés. S’ils maintenaient le cap, dès le début d’après-midi, les proues ne seraient qu’à quelques encablures du rivage. Autant dire que nul ne pensait plus à la fête. La bière donnerait du courage s’il fallait se battre.
Alors tous implorèrent Gnam. Les protègerait-il comme il l’avait toujours fait ? Seuls les arbres le diraient. Seuls les totems pouvaient parler. Et les voilà tous réfugiés et transis dans les futaies.
Les coteaux ruisselaient de leurs pleurs et lamentations. Sous l’emprise de l’excitation autant que des hallucinogènes, ils conversaient avec les troncs boursouflés. En guise de réponse, les faciès de bois restaient muets, figés dans leurs hideux rictus d’écorce épaisse et torturée. Mais les miséreux, percevaient les plaintes étouffées au plus profond des grumes à venir. La sève suintait par endroit, comme un sang épais et coagulé qui ne préfigurait rien de bon. Ainsi était la réponse de Gnam. Ils ne mettraient pas longtemps à s’en apercevoir.
Andréa Subdolo
Elle fut la première à poser un pied dans le sable. La professeuse Subdolo semblait mener l’opération. Mais une autre femme dirigeait le débarquement : La Capitaine Giovanna Dionigi connue pour sa réputation de navigatrice sévère et insensible, déterminée à conduire à toutes les victoires. Le Gouvernement de son pays l’avait missionnée en toute connaissance de cause, pour cette expédition inédite. Ainsi, elle commandait une douzaine de bâtiments, et les guidait depuis des semaines, dans d’aventureuses pérégrinations sur le Pacifique. Les autorités décrétèrent aussi, qu’au vu de l’objectif, Andréa Subdolo serait chargée des aspects scientifiques du périple. Les deux femmes pouvaient s’appuyer sur près de 300 de marins aguerris qui, en cet instant, mourraient d’envie de fouler la plage.
Au même endroit, le peuple Adalmayen formait une masse impressionnante, d’où pointait des sagaies. Il s’agissait à la fois d’impressionner les envahisseurs, mais aussi jauger de leurs intentions. Comme personne sur l’île n’était investi du pouvoir de chef, il n’y eut pas beaucoup à demander à Sipho, pour qu’il se détacha du groupe. L’homme progressa vers les deux femmes, derrières lesquelles une trentaine de marin s’agitait.
La vue de ce petit homme venant vers elles désarmé, ne pouvaient leur inspirer qu’une solide confiance dans la suite des opérations.
C’est la professeuse qui initiât le dialogue. Sa connaissance des langues régionales lui permis de s’assurer rapidement que la discussion pourrait s’établir sans confusion de sens.
- Bonjour, petit homme brave. Mon nom est Andréa Subdolo. Nous venons d’un pays par-delà les vagues. Comment te nommes-tu et qu’elle est cette île bleue ?
- Mon nom est Sipho. Nous sommes le peuple Adalmayen. Pourquoi accoster à Adalmaï ? Nous n’avons que peu de richesses, mais partagerons notre gnam avec vous.
En entendant évoquer le précieux aliment, l’exploratrice se retourna en souriant vers Dionigi, et lui annonça dans leur langue maternelle : Nous avons trouvé ce que nous cherchons ! Puis revenant vers Sipho, l’interpella :
– Montres-nous où se trouve le gnam.
L’homme ne répondit pas. Il leur fit dos, et retourna s’agglomérer à l’assemblée trépidante. S’en suivirent d’interminables conciliabules entre Adalmayens. Les voyageurs patientaient, mais leur patience s’épuisa bien vite. Entretemps des navettes s’organisèrent. Ils étaient maintenant près de 150, avec leurs bardas, quand Sipho revint vers eux, l’air grave et belliqueux.
La défaite du gnam
Ce qui se passa par la suite recouvre d’avidité et de barbarie. Refusant d’accéder à la requête des explorateurs, un combat s’engagea de façon inégale sur l’île, qui pris des allures de guérilla. Mais bien vite, au bout de la nuit, les Adalmayens durent se rendre. Les pertes étaient nombreuses. Sur le rivage s’entassaient les corps morts. Leurs visages pétrifiés de souffrance ressemblaient maintenant aux troncs totémiques.
La Capitaine pris à part Sipho qui avait mené le combat avec témérité.
- Tu es vaillant, petit homme. Mais si tu ne veux pas périr avec le reste de ton clan, tu dois nous aider à charger toutes vos ressources en gnam. Nous partirons dans une semaine. C’est largement suffisant. Choisis : Tu nous aides, où tu meurs.
Elle n’avait que faire de cette communauté, et encore moins de ce petit homme. Son engagement dans ces expéditions punitives, l’enfermait dans un sentiment d’impunité et de droiture. C’est pour ces raisons précises que les gouvernants lui avaient confié navires et équipages. L’enjeu pesait trop lourd pour le laisser grignoter par des sentiments inopportuns.
La soumission fut totale, et au bout de deux jours, toutes les réserves remplissaient les calles de trois des bateaux. Les amis de Sipho avaient pu de mauvaise grâce vider leur grenier, et aussi déterré la récolte précoce. Cela les laisserait sans ressources pour l’année à venir, les condamnant à coup sûr. Les vaincus trouvaient espoir dans le départ prématuré des affameurs. Mais il n’en était rien. Le soir, Subdolopénétra dans la maison de Themba et Sipho. Sans s’assoir, elle commenta la décision qui venait d’être prise par la Capitaine.
- Des calles restent vides et nous ne pouvons reprendre la mer ainsi. Nous aussi nous mangeons des racines, mais une maladie à détruit à jamais nos cultures. Nous savions que dans ce coin de l’océan, il y avait un tubercule similaire. C’est pourquoi nous sommes ici. Cependant il nous faut compléter la cargaison. Nous allons prendre les arbres. Les plus jeunes seront replantés loin d’ici ; les plus anciens nous serviront de bois. Nous en tirerons un bon prix. Alors voici une bourse d’or et d’argent pour vous indemniser. Tu iras rapporter aux autres le travail qui les attend demain. Dionigi compte sur toi.
Puis elle sortit sans même attendre de réponse à ce qui était décrété. Le couple découvrait ces disques de métal brillants. Ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils pouvaient en faire.
Naturellement, la mise en œuvre de la décision ne se fit pas sans vives et sanglantes résistances, d’autant que l’on touchait à l’âme d’Amaldaï. Sans Dieu, qu’allait-il devenir ? Sans avenir et sans passé, mériteraient-ils d’être encore des humains ?
La mécanique d’abatage et d’arrachage se mit en place, avec méthode d’un côté, et désespérance de l’autre. Certains préféraient se laisser mourir au pied de leur arbre, pendant que la lame des haches en entamait le tronc.
En reprenant la mer, les explorateurs laissaient derrière eux, le drame des familles endeuillées, le désespoir des survivants, et une île caillouteuse qui avait perdu son bleu, et son Dieu.
La flamme de l’enfer
Vous, des pays d’hiver, regardez bien ce que les flammes de votre foyer rongent avec toute la rapacité du feu. Regardez avec attention…vous les voyez ces bûches ? Détaillez les bien maintenant…là…c’est bien. Ces nœuds boursoufflés, vous ne trouvez pas qu’ils ressemblent à des visages hideux, des corps meurtris ? C’est peut-être les restes des forêts de l’île bleue ? Et dans le crépitement et le souffle de l’âtre, vous entendrez, en y prêtant attention, les gémissements du Dieu Gnam dévoré par ses brûlures. Le Dieu maudit d’Aldamaï.
Epilogue
C’est moi Sipho. Sipho que l’on n’appelle plus, un nain. Je ne vous ai pas tout raconté. Pendant la razzia qui décima nos forêts, les destructeurs avides mobilisèrent les efforts sur les grands arbres et les plants naissants dont ils pouvaient tirer profit. Mais aucun n’a repéré ce tout petit arbre enfoui dans l’humus. Mon arbre. Mon totem. Ma difformité. Grâce à lui, nous pûmes exploiter de nouveau la culture, et nous nourrir tout autant. Ses gnams n’avaient jamais été si gros et si nombreux. Ce petit végétal de surface cache richesse et prodigalité. C’est par respect que l’on n’entaille plus les arbres aujourd’hui. Il n’y a plus de Dieu. Alors vous me direz :« où trouvez-vous votre réconfort ? ».
Et bien, penchez-vous sur ce petit arbre. Prenez cette loupe épaisse. Vous découvrirez que les scarifications du passé forment aussi des visages. Mais l’écorce maintenant dessine des sourires bienveillants. Ils nous aident à vivre et à nous aimer, mon peuple, les étrangers de passage, et surtout ma tendre Themba et moi, avec notre bébé.
Quant à Andréa Subdolo, elle ne reste d’elle que son carnet de notes. Lors de leur traversée de retour, certains navires avaient tellement chargé de bois, que 4 dessalèrent dès le premier coup de vent. La scientifique était à bord de l’un d’eux, a-t-on raconté.


Cot part
Une poularde s’éveille dans un cabas, entraînant un cuisinier dans une aventure absurde, entre révolte et amour… des gallinacés.
Nouvelle primée 2023 Les Mots en grappe

« Détache-moi ». Seul dans ma cuisine, qui pouvait bien m’interpeller ainsi ? La fenêtre ouverte me rassura. Je m’empressais de la refermer, pour enfin me concentrer sur la préparation du déjeuner.
« J’étouffe là-dedans. Libère-moi ». Cette fois-ci, la voix venait distinctement de mon cabas. Je m’en approchais ; écartais les anses d’osier, et plongeais mes mains dans l’entassement du marché. Au fond, une masse molle semblait onduler. Je la saisis, avec la délicatesse d’un chirurgien qui tient un cœur battant avant de le transplanter.
Je déposais ma poularde emmaillotée sur le plan de travail et attendis. Sa tête tout emplumée pendait inerte. Les paupières bleutées clignèrent soudain, pour s’ouvrir largement sur une pupille sans âme qui me fixait. Le bec s’entrouvrit, et cette fois-ci, plus de doute : elle était encore vivante.
« Fais vite. Je saurais te remercier comme il se doit ». Ma poule me parlait ! Il y avait là, quelque chose d’inacceptable, qui défiait toutes mes certitudes. J’aurais voulu y mettre fin, et saisissais le couteau de cuisine. Mais dans un élan d’humanité, je dénouais le ruban satiné qui l’entravait, et tranchais le sac de toile, qui comprimait un corps oblong, libérant ainsi l’animal.
La forme se détendit, puis face à moi, figé de stupéfaction, se dandina jusqu’à se retrouver un équilibre instable sur ses deux pattes dorées.
« Merci », caqueta-t-elle en s’ébrouant. Elle ajouta : « Il fait froid ici ». Cette poule avait tous les culots. Critiquer ainsi mon chez-moi, alors que je venais de sacrifier mon repas dominical, ne la dérangeais nullement. Et toute effrontée, malgré son allure malingre de volatile sans plume, toisa ma cuisine.
« Tes intentions n’étaient guère très bonnes à mon égard, si j’en juge l’atelier culinaire où tu m’as conduite. Que voulais-tu faire de moi ? »
Je n’avais aucune envie de lui répondre. Est-ce que j’ai une tête à parler à une poule ? Une poule ressuscitée de surcroît ?
« Tu voulais me manger, c’est cela ? » Dit-elle accusatrice.
Je finis par céder. « Ben oui. C’est ça. Je t’ai achetée pour te rôtir ». En prononçant ces mots, j’en percevais la cruauté. Dire à quelqu’un qu’on le destine aux pires souffrances, tient presque de l’Inquisition ; fusse à son poulet du dimanche.
« Tu as changé tes projets, semble-t-il. J’en suis fort aise. Je t’en suis reconnaissante. Comment puis-je te remercier ? »
Avant de la suivre dans ce délire surréaliste, je voulais en savoir davantage :
« Dis-moi, volaille, comment cela est-il possible ? Comment une poularde morte peut-elle survivre, et parler mon langage ? »
« Je comprends ton étonnement. J’ai toujours vécu avec ceux de ton espèce. Ils m’ont nourrie avec soin, et veillé avec attention, à ce que je ne manque de rien ». Puis me fixant à nouveau en tendant son cou de peau flasque ajouta : « Je ne suis pas n’importe qui, vois-tu. Je suis la Reine de la basse-cour. Ma lignée me confère des pouvoirs que vous ignorez. Chaque année, on me trucide, on me lace dans un linceul étriqué à en faire exploser mes chairs, puis ma dépouille est vendue au plus offrant. Toi aujourd’hui ». Je la sentais pleine d’orgueil et de mystère. Elle sautilla jusqu’au rebord de la table, puis d’un bond d’élança. Sans plume, ses deux bras nus s’agitaient désespérément pour amortir sa chute. Mais elle s’écrasa dans un bruit sourd et flasque sur le carrelage.
Après avoir repris ses esprits, elle se rabroua, et fière me lança : « J’oublie toujours. C’est pareil à chaque fois. Mais ce n’est pas grave. Conduis-moi à mon élevage ».
Qu’attendait-elle de moi exactement ? Toujours interloqué, je le lui demandais.
« Je me dois de revenir. On m’attend là-bas. Mon amour de coq et moi devions convoler. Tu sais, nous aussi les poules pouvons aimer. Mais vous, souvent, ne gardez nos entrailles, et jetez aux chiens nos cœurs éviscérés. Vous ne nous voyez que comme un mets comestible et délicat. Écoute, aide-moi à vivre cet impossible amour ».
« Petite poularde, tu as beau être reine en ton enclos, je n’ai pas pour habitude de négocier avec ma nourriture. Mais je suis sensible à tes confidences, et je vais te ramener à ton éleveur. Mais avant, deux choses : comment oser réapparaître nue, sans plumage ? Ensuite, parle-moi de ce coquelet qui t’attend ».
« Pour ma pudeur, ne t’inquiète pas. Cela aura tôt fait de repousser, et en attendant, les lambeaux de ce sac de toile qui m’entravait, me serviront de chappe royale ».
« Et ton coq chéri ? »
« C’est le plus merveilleux des gallinacés. Il est de souche royale, tu sais, aussi. C’est un coq altier, dont le ramage résonne chaque aurore, pour réaffirmer la gloire de notre espèce. Si tu écoutes bien le cri, ce n’est pas un cocorico. Les mots prononcés sont très exactement : conquête et vie. C’est notre devise. Elle invite chacune et chacun de nous, à survivre à une nouvelle aube, dans le respect de la vie. Ce n’est pas évident, quand tu te lèves tous les matins dans un enclos grillagé. Mon coq donne cet espoir, et moi, je panse les plaies de mes congénères tout au long de la journée, en écoutant leurs confidences existentielles et leur prodiguant maints conseils rassurants. Si tu ne me ramènes pas là-bas, non seulement, tu me condamnes à une vie sans amour, mais tu prives tout un peuple d’espoir ».
Vous vous demandez, ce que j’ai fait par la suite ? Comment ne pas être touché par de si nobles intentions. Et bien, je l’ai remise dans mon cabas et reconduite vers l’élevage. Que vouliez-vous que je fasse d’autre ?
Maintenant, quelques mois ont passé. Évidemment, je n’avais jamais raconté cette histoire insensée, avant d’écrire ces quelques pages. J’ai mis quelque temps à renouer avec le poulet rôti du dimanche. Mais la tradition familiale a été plus forte, que mes scrupules et ma sensiblerie. Il y a juste…
Écoutez, il faut que je vous confesse quelque chose. Quand je flâne sur le marché de Lons, et que je m’arrête sur le stand de ma volaillère préférée, je reste un bon moment à considérer tous les petits corps emmaillotés. Je peux passer une bonne heure à tous les détailler. Certes, cela irrite un peu la commerçante et les chalands qui font la queue. Mais je veux m’assurer qu’aucune poularde ne gigote dans son torchon. Et surtout, je les dévisage toutes, pour voir si je reconnaîtrais ma poule.
Je suis sûr qu’elle a refait sa vie, avec son coq d’amour. Je suis certain qu’elle règne en souveraine pleine de bienveillance et de sollicitude. Comment je le sais ?
Et bien au sourire de chacune des volailles exposées. Oui, regardez bien, la prochaine fois. Vous verrez qu’elles semblent sourire dans leur sommeil éternel, leur part de sérénité d’une vie accomplie, leur cot part de bonheur.


Double « je »
Un dîner de Saint-Valentin, entre complicité et introspection, où l’amour trouve une résonance inattendue face à un reflet silencieux mais profond.

Nous nous étions attablés sans trop d’empressement. La soirée serait longue. Surtout pour moi. La Saint-Valentin est une bien curieuse tradition contemporaine. Difficile de rester neutre ; avec ou sans compagne ou compagnon.
Le bouquet double d’œillets mauves remplaçait les traditionnelles roses. Il me connaissait bien. Très bien même. Peut-être plus que moi ! Nous nous fréquentions depuis si longtemps. Mes goûts les plus intimes n’avaient plus de secret pour lui, et il en jouait avec habilité et bienveillance. Les années passant, tout me laissait croire que nous ne nous étions jamais vraiment éloignés.
Face à face, nous apprécions muets, la mélodie dépoussiérée d’un répertoire bien désuet. C’est dans les grandes occasions qu’il faut sortir la bouteille d’exception. Pour la musique, c’est pareil. Les vieux morceaux prennent une saveur nouvelle quand le millésime a vieilli. Nous les aimons, mais pas de la même façon. Il en était de même pour nos sentiments.
Ce que nous éprouvions l’un pour l’autre avait trouvé naissance, il y a longtemps dans des jeux adolescents. Mais le temps, en restituait aujourd’hui une forme nouvelle. La même intensité, la même ferveur, mais surannées, polies, usées. Cependant, si la passion s’est dissoute dans le quotidien de notre couple, le sentiment perdure avec la même intensité. Un tison de braise qui peut, à chaque instant, se raviver au contact de l’un ou de l’autre.
C’était encore un bien bel homme, comme le disent encore les dames d’un certain âge. Son visage n’avait rien perdu de sa beauté, malgré les vicissitudes du temps, et les lubies de la coquetterie. Je l’avais connu glabre, boutonneux, puis barbu. A une époque, il s’était empâté avec le confort de la quarantaine. Loin de l’enlaidir, cela rassurait. Rien ne lui enlevait son charme certain. Et puis, nous vieillissions de concert. Les mêmes rides, les mêmes poches sous les yeux, les mêmes reflets blancs. Il pouvait dire de moi, ce que je disais de lui. Les yeux de l’amour ont ceci de fantastique : c’est qu’ils ne voient de ce qu’ils regardent, que le cœur des choses.
Je ne l’avais pas toujours aimé, et souvent trompé. Mais, las de mes incartades à répétition, il ne m’en tenait aucune rigueur, voire même, semblait s’en délecter. La jalousie n’a jamais été un désaccord, dans la partition de notre couple. Et il est tout à fait possible d’aimer sans la frustration d’une tromperie passagère. C’est peut-être cela le vrai attachement à l’autre. La puissance d’un amour au-delà de l’amour.
Les fruits de mer passèrent ainsi, à nous regarder sans parler. A communiquer sans parole, en laissant les mélodies s’enchaîner dans des volutes de nostalgie doucereuse.
Une fois les carapaces remisées, j’attendais un temps avant de servir. Nous trouvâmes alors amusant d’avoir simultanément le même réflexe. C’est dire la complicité implicite qui nous unit. J’aimais, comme lui, racler un peu de mayonnaise sur le quignon de pain restant, et l’engouffrer comme une confiserie salée. Nos goûts étaient identiques. Une symbiose parfaite au bout de tant de vie commune, est une richesse que je souhaite à toutes et à tous. Cela enlève un peu d’effet de surprise, c’est vrai. Mais c’est tellement agréable de vivre avec quelqu’un de prévisible ; quelqu’un dont on peut désamorcer les peines et anticiper les joies.
Aïe ! L’agneau gambade dans les champs de flageolets. Pas facile de se la jouer glamour. Fort heureusement, la volupté ne nous a jamais quittés. Nous pouvons en parler, si vous voulez ? Les moments de célébration, sont aussi des opportunités pour faire le point ; prendre du recul sur ce que la vie nous offre où nous reprend. Et puis, ne soyons pas hypocrites, la fête des amoureux est aussi une question de sexe. Plus que de genre, d’ailleurs. De ce côté-là, je reste lucide aussi. Il a toujours compris ce qui pouvait me procurer du plaisir. Je ne lui en demande pas plus. Il y a un âge pour rêver à l’amant idéal. Je le regarde. Je regarde ses mains. J’aime bien la façon avec laquelle il manie sa fourchette. La sensualité avec laquelle, il l’étreint délicat, puis l’enserre plus fermement pour la porter vers sa bouche, et faire pénétrer dans son palais, tout ce qu’elle contient de délices et de saveurs. Il sait ce que je pense. Je m’arrête et le fixe. Yeux contre yeux. Ce sont des rares moments de communion profonde ; insondable. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos regards échangent des milliers d’informations muettes, nous déshabillent de l’intérieur. La vérité est aussi crue que si nous regardions les étoiles. Nous ne sommes rien sans l’autre. Et l’amour naît de ce néant, comme par magie et enchantement.
Cette mousse chocolatée est délicieuse. Ce sera mon petit cadeau de Saint-Valentin. Il sait que j’adore tout ce qui vient des cabosses. Il s’en délecte aussi, goulûment. Le chocolat forme des petites virgules amusantes à la commissure de ses lèvres, comme un sourire noir et involontaire. Habituellement, il ne me sourit qu’en de très rares occasions. Et toujours par un petit rictus furtif, qui déforme sa moue. Je le lui rends bien, en faisant de même. Il est mon double, plus que ma moitié. Lui dire que je l’aime serait impudique et déplacé ici. Il pense que cela se vit, plus que cela se formule. Je me range à cette idée. En fait, nous sommes sur la même onde de langueur. Pour cela et pour le reste.
Notre amour est affection, attachement, complicité, force vitale. Je n’existe pas sans lui et lui sans moi. La réciprocité de nos destins est imparable, et nul ne saurait y mettre fin, sans nous anéantir tous les deux.
La musique s’est arrêtée, sans que nous y ayons prêté attention. Trop perdus dans nos pensées respectives. Notre repas s’achève dans une gorgée de champagne. Notre échange reste suspendu comme une bulle de non-dit dans un océan d’amour.
Je sors de table. Naturellement, il fait de même. Me voilà seul maintenant. Seul jusqu’à ce que je croise de nouveau mon reflet. Ce soir, dans la salle de bain, où je viens de replacer le miroir installé pour l’occasion, face à moi, sur la table de ce dîner.
Car même seul, on peut pourtant ressentir de l’émoi ce soir-là. Découvrir des aspects nouveaux de soi-même. Se pardonner nos défauts, et chercher à vivre en paix avec soi, dans une exaltation réaliste, qui ressemble peut-être à l’amour.


Au nom de la chose
Dans une ville où les libertés s’effacent comme une forêt disparue, un journaliste attend son jugement, entre peur et résignation.

Il y avait une forêt ici. Une futaie si dense que l’on s’y perdait autrefois. Une forêt profonde, érigée de chênes, de hêtres et de bouleaux. De hautes ramures interdisant la lumière à tout ce qui grouillait à terre. Et de l’humus devenu noir, se nourrissaient maintes légendes aux pousses de drames et de mystères. D’aucuns s’y aventuraient sans jamais revenir. Au fil des siècles, les abatages puis les tronçonnages fournirent l’énergie et l’espace nécessaires aux activités humaines. La forêt disparut et ses superstitions avec.
Aujourd’hui, le lieu organise son paysage d’immeubles, tailladé des saignées du périphérique. Une zone sans relief ni limite, où se confondent l’industriel et le résidentiel. En y regardant bien, l’empreinte du passé subsiste pourtant, d’une toponymie cruelle. « La Forêt » est une cité connue de tous. La rue des Chênes, l’avenue des Hêtres, la contre-allée des Bouleaux…Ses noms gardent la trace de ce qu’elles ont détruit. Leurs plaques de métal célèbrent une nature morte, comme d’autres, en d’autres lieux, honorent les noms d’illustres figures du passé.
Dans mon appartement, j’attends. D’indistincts nuages donnent aux façades la couleur du plomb. Je regarde par la vitre, sans fixer l’agitation de rue, sinon le vague ballet des voitures qui se garent en bas. J’ai reçu ce matin, un courrier officiel ; une convocation du Tribunal. Je n’ai rien fait. Rien à me reprocher. Mais les autorités en ont décidé autrement. Mon crime ? Avoir écrit dans mon journal, que certains de mes concitoyens étaient chassés de leur terre, pour laisser place à de géantes piscicultures d’Etat ; des crevettes gouvernementales, en sorte. En bon journaliste prudent, je ne suis pas allé jusqu’à écrire que cela sentait la corruption et le blanchiment à plein nez. Ma rédaction n’aurait pas laissé passer. Mais ici, tout le monde sait lire entre les lignes le filigrane de la contestation. Je risque gros, je le sais. De la prison à coup sûr. C’est courant ici et personne ne s’en émeut de peur de représailles.
J’ai la trouille. Une peur viscérale. Dans mes entrailles, un nœud se resserre en un étau invisible qui broie mon esprit. Mais que faire ? Tout quitter et gagner la clandestinité ? La fuite est aussi une prison. Alors tant pis. J’ai bien vécu. Et puis une rédemption du Pouvoir reste toujours une hypothèse, à défaut d’un véritable espoir. Car on ne s’évade pas des geôles d’Etat. On disparaît aux yeux de tous. On disparaît comme s’efface notre confort, notre libre-arbitre, puis notre humanité.
J’ai peur dans ce bus qui m’emporte. Ce bus qui me conduit vers le Palais de justice qui ne porte ce nom, qu’en souvenir vague d’une équité d’antan. Comme la mémoire d’une forêt disparue survit sur une plaque de métal, au détour d’une rue.
Par réflexe autant que par angoisse, je souris, en descendant du bus qui me livre aux uniformes. Car l’arrêt porte le nom de la place ou siège le Tribunal National ; la place de la Liberté.


Fleurs de Kalach
Deux hommes contemplent une nature vibrante et éphémère, tandis que l’ombre d’un combat inéluctable plane sur ces instants de paix.

- Regarde-moi ce paysage !
- Bof. Tu sais, moi, la nature…
- Tu n’entends pas ces oiseaux, ces dizaines d’outardes en migration ? Tends l’oreille et écoute au loin. Tu entends le troupeau qui sort de la bergerie, et les chiens qui gueulent, à fendre le brouillard ?
- Ça ne te fait pas peur à toi ? D’habitude, dès que tu sors, tu balises comme un mioche.
- Et bien, non. Pas là. C’est curieux. C’est vrai, en général quand je franchis le pas de l’immeuble, j’ai tendance à vouloir me barrer. Mais là, tu vois, c’est autre chose. Regarde. Tu vois ces collines dont le vert à l’horizon commence à prendre de la nuance, avec le soleil qui les caresse.
- Tu ne serais pas en train de devenir poète, toi ?
- Tais-toi et laisse-moi contempler cette nature qui s’éveille. C’est tellement beau, ces bosquets qui dépassent, comme des icebergs de verdure, de cet océan de blé et d’escourgeon.
- Connais pas. C’est quoi l’escourgmachin ? De l’herbe ? Ça se mange ou ça se fume ?
- Laisse tomber. C’est des céréales. Devant toi, ces étendues blondes qui ondulent à la brise finissante. Bientôt, au cœur de l’été, le paysan viendra les faucher pour en négocier les grains, et nouer la paille pour la litière de ses bêtes. D’ailleurs, ne vois-tu pas de ce côté, la machine qui progresse sur le chemin, comme un gros insecte caparaçonné de ferraille ?
- Ah oui. On ne peut pas la manquer, avec toute la poussière. Bon, on y va ?
- Attends encore un peu. Laisse-moi admirer ce paysage qui s’offre à nous, comme un artiste de music-hall. Ces cours d’eau qui susurrent la rengaine d’un temps heureux, en serpentant au creux des vallons de nostalgie. Aller. Pose ta kalach dans l’herbe grasse. Assieds-toi et profite. Ce n’est pas tous les jours quand même qu’on voit ça.
- Bon. D’accord. Mais pas longtemps, car ils vont revenir.
- Je sais bien, mais justement, le temps est une valeur rare maintenant. J’aime sentir cette nature opulente. Ces bouffées fleuries. La fragrance de toutes ces plantes des montagnes ; le sainfoin, la digitale, l’absinthe et la renoncule. Ça m’enivre. Ça me grise. J’en ai besoin.
- C’est vrai qu’on n’a pas grand-chose d’autre sous la main pour se soûler ici.
- Tu sens ? Ferme les yeux et inspire.
- OK. J’inspire.
- Tu sens…Tu sens ? …Tu t’es endormi ou quoi ?
- Un peu, oui. C’est toi avec toutes tes phrases. Ça finit par me rendre à moitié je-ne-sais-pas-quoi.
- A moitié, heureux ?
- …Oui, c’est ça ; je me sens bien. Ça fait peur.
- Je suis comme toi. Il y a bien longtemps qu’on n’a pas ressenti ce qu’était le bonheur. La plénitude. L’absolu.
- Tu ne vas pas un peu trop loin ? On est juste assis là, dans l’herbe, en train de regarder devant, derrière et sur les côtés, si leurs bagnoles déboulent.
- Je ne crois pas qu’il s’agisse uniquement de guetter leur arrivée. De toutes les façons, on n’y peut rien. Si on leur avait donné ce qu’ils attendaient, on n’en serait pas là.
- On a fait une connerie, c’est sûr. Faut payer maintenant. Alors ici ou ailleurs…
- Je suis de ton avis. Mais je préfère que ce soit ici. Dans ce paysage qui change encore, regarde. Bientôt, nous en ferons partie. Même en ripostant, on est certains de perdre. Alors, il faut se faire une raison.
- Oui, nos cadavres formeront de petits vallons, et nos sangs couleront en de petits ruisseaux chantants, qui nourriront la terre, sous le regard des oiseaux migrateurs qui, dans les nuées, salueront de leurs cris aigus, la mémoire de nos âmes apaisées.
- Tu ne serais pas en train de devenir poète, toi ?

